L'Empire avait cru sans doute que notre peuple ne tiendrait pas sa parole quand, en des jours incertains du siècle passé, nous avions affirmé que, même si l'URSS disparaissait, Cuba continuerait de se battre.
La Seconde Guerre mondiale éclata le 1er septembre 1939 quand le nazi-fascisme envahit la Pologne. Il tomba ensuite comme la foudre sur le peuple de l'URSS dont l'héroïsme, au prix de 27 millions de vies soviétiques, permit de sauver l'humanité de cette épouvantable boucherie qui causa plus de 50 millions de morts.
La guerre reste pourtant la seule activité que les humains, tout au long de leur histoire, n'ont jamais été capables d'éviter. C'est pour cela que Einstein répondit un jour que s'il était incapable de dire quelle type d'armes seraient utilisées pour faire la troisième guerre mondiale, il avait par contre la certitude que la quatrième se ferait avec des bâtons et des pierres.
Les deux plus grandes puissances, les États-Unis et la Russie, disposent à elles seules de plus de 20 000 ogives nucléaires. L'humanité ne devrait pas oublier que, 3 jours après l'arrivée du président états-unien John F. Kennedy, le 20 janvier 1961, à la Maison-Blanche, un bombardier B-52 qui transportait 2 bombes atomiques ayant un pouvoir de destruction 260 fois supérieure à celle d'Hiroshima, s'écrasa au sol à la suite d'une défaillance mécanique survenue pendant un vol de routine. Dans ces cas, des équipements sophistiqués sont censés empêcher les bombes d'exploser. La première heurta le sol sans conséquence. Quant à la seconde, 3 de ses 4 mécanismes de sécurité ne fonctionnèrent pas, et le quatrième, dans un état critique, fonctionna à peine. C'est par le plus grand des hasards que cette bombe n'a pas éclaté.
Aucun événement présent ou passé - de ceux dont je me souviens ou dont j'ai entendu parler - n'a ému l'opinion publique mondiale davantage que la mort de Mandela, non pas du fait de ses richesses mais en raison de ses qualités humaines et de la noblesse de ses sentiments et de ses idées.
Avant que les machines et les robots - voilà à peine un siècle et demi - ne prennent en charge nos occupations les plus modestes à moindre coût, l'humanité n'avait jamais connu, tout au long de son histoire, aucun des phénomènes qui la bouleversent aujourd'hui et qui régissent inexorablement les destinées de chacun de nous, hommes et femmes, enfants et vieux, jeunes et adultes, agriculteurs et ouvriers, travailleurs manuels ou intellectuels. Les populations ont tendance à s'installer surtout dans les villes où la création d'emplois, de transports et de conditions de vies élémentaires exigent des investissements énormes au détriment de la production alimentaire et d'autres formes de vie plus raisonnables.
Trois nations ont réussi à poser des engins sur la Lune de notre planète. Le jour même où Nelson Mandela, enveloppé dans le drapeau de sa patrie, était inhumé dans la cour de l'humble maison où il était né il y a 95 ans, la République populaire de Chine faisait se poser un module en un lieu éclairé de notre Lune. Simple coïncidence.
Des millions d'hommes de science étudient les matières et les rayonnements sur la Terre et dans l'espace. C'est grâce à eux que nous savons qu'il y avait à Titan, une des lunes de Saturne, 40 fois plus de pétrole que n'en comptait la Terre au moment où l'exploitation du brut a démarré, voilà à peine 125 ans, une exploitation qui au rythme actuel de la consommation ne durera guère plus d'un siècle.

Après sa victoire, la Révolution cubaine se mit en devoir d'apporter sa solidarité, et ce dès les premières années, aux mouvements de libération qui, dans les colonies portugaises en Afrique, tenaient en échec le colonialisme et l'impérialisme depuis la Seconde Guerre mondiale et la libération de la République populaire de Chine, le pays le plus peuplé du monde, et après le triomphe de la Révolution socialiste russe.
Les révolutions sociales faisaient chanceler le vieil ordre des choses. En 1960, la planète comptait déjà 3 milliards d'habitants. On voyait monter en puissance les grandes sociétés transnationales - presque toutes états-uniennes et siégeant donc dans un pays qui, grâce à sa monnaie, étayée par le monopole de l'or et par une industrie intacte parce que située loin des champs de bataille, fit main basse sur l'économie mondiale. Le président états-unien Richard Nixon décida unilatéralement de mettre fin à la convertibilité du dollar en or et les entreprises des États-Unis purent ainsi s'emparer des principales ressources et matières première de la planète en les achetant avec du papier vert.
Rien de nouveau jusque là. Ce sont des choses que tout le monde sait parfaitement.
Mais, pourquoi cherche-t-on à cacher que le régime de l'apartheid, qui infligea tant de souffrance à l'Afrique et indigna l'immense majorité des nations du monde, était un pur produit de l'Europe coloniale et que ce sont les États-Unis et Israël qui en firent une puissance nucléaire, ce que Cuba, qui soutenait la lutte des colonies portugaises africaines pour leur indépendance, condamna sans la moindre ambiguïté ?
Notre peuple, dont la patrie fut cédée par l'Espagne aux États-Unis alors qu'il venait de mener une lutte héroïque de plus de 30 ans pour son indépendance, ne s'était jamais résigné au régime esclavagiste qu'on lui avait imposé pendant près de 400 ans.
C'est de la Namibie, colonie occupée par l'Afrique du Sud, que partirent en 1975 les troupes racistes qui, accompagnées de chars légers équipés des canons de 90 mm, pénétrèrent de plus de 1 000 kilomètres en Angola, jusqu'aux abords de la capitale, Luanda, où elles furent freinées par un bataillon des troupes spéciales cubaines, arrivé de Cuba par avion, et par le personnel, également cubain, de plusieurs tanks de fabrication soviétique. C'était en novembre 1975, 13 ans avant la bataille de Cuito Cuanavale.
J'ai déjà dit que Cuba n'agit jamais en quête de prestige ou d'avantages. C'est un fait que Mandela était un homme intègre, profondément révolutionnaire et radicalement socialiste, qui endura 27 ans de prison avec un grand stoïcisme. J'ai toujours admiré sa dignité, sa modestie et ses énormes mérites.
Cuba s'acquittait comme il se doit de son devoir internationaliste. Elle défendait des points clefs et formait chaque année des milliers de combattants angolais au maniement des armes fournies par l'URSS. Mais nous ne partagions pas les vues du principal conseiller militaire soviétique. Des milliers de jeunes Angolais s'incorporaient aux unités en formation de l'armée de leur pays. Or, ce conseiller principal soviétique n'était pas - loin de là - un Joukov, un Rokossovki, un Malinovski ou l'un de ces brillants stratèges militaires si nombreux qui firent la gloire de l'Union soviétique. Une idée l'obsédait : celle d'envoyer des brigades angolaises équipées du meilleur armement dans le territoire où semblait se trouver le gouvernement tribal de Savimbi, un mercenaire au service des États-Unis et de l'Afrique du Sud. Cela revenait en quelque sorte à avoir donné aux troupes soviétiques qui se battaient à Stalingrad l'ordre de marcher sur la frontière de l'Espagne phalangiste, dont le régime avait envoyé plus de 100 000 soldats se battre contre l'URSS. En Angola, pourtant, une opération de ce genre était en cours à cette époque-là.
L'ennemi avançait donc, à la poursuite de plusieurs brigades angolaises qui avaient été durement frappées à proximité de l'objectif qu'elles étaient supposées atteindre, à environ 1 500 kilomètres de Luanda, et qui se repliaient en direction de Cuito Cuanavale, une ancienne base militaire de l'OTAN, à une centaine de kilomètres de la 1ère brigade blindée cubaine.
C'est à ce moment critique que le président angolais demanda l'aide des troupes cubaines. Le chef de nos forces dans le Sud, le général Leopoldo Cintra Frías, nous transmit la demande. Nous répondîmes que nous apporterions notre aide si toutes les forces et tous les moyens angolais engagés sur ce front étaient mis sous les ordres du commandement cubain présent dans le Sud de l'Angola. Il était clair pour tous que notre exigence était une condition indispensable pour faire de l'ancienne base le champ de bataille idéal pour frapper les forces racistes sud-africaines.
L'Angola nous fit parvenir son feu vert en moins de 24 heures.
Il fut alors décidé d'envoyer immédiatement à cet endroit-là une brigade cubaine de tanks. Plusieurs autres étaient cantonnées sur cette même ligne en direction de l'Ouest. La principale difficulté résidait dans la boue et le sol gorgé d'eau à cause de la saison des pluies, et il fallait déminer chaque mètre de terrain, essentiellement à la recherche de mines antipersonnel. On envoya aussi à Cuito le personnel cubain nécessaire à l'utilisation des tanks qui n'avaient pas d'équipage et des artilleurs pour les pièces d'artillerie, pour lesquelles on manquait également de personnel.
La base en question était coupée du territoire situé à l'Est par le Cuito, un grand fleuve au débit rapide traversé par un pont solide. L'armée des racistes sud-africains attaquait ce pont désespérément jusqu'au jour où un avion téléguidé bourré d'explosifs parvint à s'y encastrer et à le rendre inutilisable. Les tanks angolais qui battaient en retraite furent alors obligés de franchir le Cuito en passant par un endroit situé bien plus au nord. Ceux qui n'étaient plus en état de marche furent enterrés, avec leurs canons pointés vers l'est. En même temps, une frange de terrain densément parsemée de mines antipersonnel et de mines antitank faisait de l'autre rive du fleuve un piège mortel. Quand les forces racistes reprirent leur progression, elles s'écrasèrent contre cette muraille, toutes les pièces d'artillerie et tous les tanks des brigades cubaines leur tirant dessus depuis leurs positions dans la zone de Cuito.
Nos avions de combat MiG-23 jouèrent un rôle spécial en attaquant sans cesse l'ennemi. Alors qu'ils volaient à près de 1 000 km/h, leurs pilotes étaient capables de distinguer, en faisant du rase-mottes, si les servants des pièces d'artillerie étaient des noirs ou des blancs.
Quand l'ennemi, épuisé et bloqué, entreprit de se retirer, les forces révolutionnaires se préparèrent aux derniers combats.
De nombreuses brigades angolaises et cubaines, se déplacèrent rapidement et suffisamment éloignées les unes des autres vers l'Ouest où se trouvaient les seules routes assez larges, sur lesquelles les Sud-Africains s'engageaient toujours pour entreprendre leurs actions contre l'Angola. L'aéroport, en revanche, se trouvait à environ 300 kilomètres de la frontière avec la Namibie, qui était encore totalement occupée par l'armée de l'apartheid.
Tandis que les troupes se réorganisaient et se ravitaillaient, il fut décidé de construire de toute urgence une piste d'atterrissage destiné aux MiG-23. Nos pilotes utilisaient alors les avions livrés par l'URSS à l'Angola, dont le personnel n'avait pas eu le temps de recevoir la formation nécessaire. Plusieurs avions étaient inutilisables après avoir été parfois pris sous le feu de notre propre DCA. Les Sud-Africains occupaient encore une partie de la route nationale qui mène vers la Namibie depuis le bord du plateau angolais. Pendant ce temps, ils s'amusaient à pilonner les ponts qui traversaient le puissant fleuve Cunene, entre le Sud de l'Angola et le Nord de la Namibie, avec leurs canons de 140 mm ayant une portée de près de 40 kilomètres.
Le problème fondamental résidait dans le fait que les racistes sud-africains possédaient, selon nos calculs, 10 ou 12 armes atomiques. Ils avaient même fait plusieurs essais nucléaires, y compris dans les mers ou les régions congelées du Sud. Le président [des États-Unis] Ronald Reagan ayant donné son feu vert, Israël leur avait livré, entre autres équipements, les détonateurs destinés aux engins nucléaires. Nous avions donc organisé nos troupes en groupes de combat, dont aucun ne comptait plus de 1 000 hommes et qui devaient se déplacer de nuit sur une vaste étendue de terrain, accompagnés de systèmes mobiles de DCA.
Selon les renseignements fiables dont nous disposions, les Mirage des Sud-africains ne pouvaient pas porter ces armes atomiques. L'ennemi avait donc besoin de bombardiers lourds, du type Canberra. De toute façon, notre DCA disposait de nombreux types de missiles capables d'atteindre et de détruire des cibles aériennes à plusieurs dizaines de kilomètres de nos troupes.
En même temps, les combattants cubains et angolais avaient occupé et miné un barrage situé en Angola qui contenait 80 millions de mètres cubes d'eau. En faisant sauter ce barrage, nous aurions obtenu un effet similaire à celui de plusieurs armes nucléaires.
De son côté, un détachement de l'armée sud-africaine occupait une centrale hydroélectrique construit sur le Cunene, près de la frontière namibienne.
Quand les racistes se mirent à utiliser, dans ce nouveau théâtre d'opérations, leurs canons de 140 mm, les MiG-23 s'en prirent sans pitié à ce détachement de soldats blancs, dont les survivants décampèrent en laissant même sur place des graffiti contre leur commandement. Telle était la situation lorsque les forces cubaines et angolaises marchèrent sur les lignes ennemies.
J'ai su par la suite que Katiuska Blanco, auteur de plusieurs récits historiques, se trouvait là-bas, avec des journalistes et des reporters. La situation était tendue, mais tout le monde gardait son sang-froid.
C'est à ce moment-là que nous apprîmes que l'ennemi voulait négocier. Nous avions réussi à mettre un terme à l'aventure impérialiste et raciste dans un continent dont la population doit dépasser, d'ici 30 ans, la somme des habitants de la Chine et de l'Inde.
La délégation cubaine qui a participé aux obsèques de notre frère et ami Nelson Mandela a joué un rôle inoubliable.
Je félicite le camarade Raúl pour son attitude et, en particulier, pour sa fermeté et sa dignité quand, d'un geste aimable mais ferme, il a salué le président des États-Unis en lui disant en anglais : « Monsieur le Président, je suis Castro. »
Quand mon état de santé a mis des limites à mes capacités physiques, je n'ai pas hésité un instant à exprimer mon opinion sur celui qui était, à mon avis, à même de prendre la relève. Toute la vie d'un homme ne représente qu'un bref instant dans l'histoire des peuples et je pense que ceux qui assument aujourd'hui certaines responsabilités doivent avoir l'expérience et l'autorité nécessaires pour pouvoir faire les choix qui s'imposent face à un nombre croissant, presque infini, de variantes.
L'impérialisme gardera toujours dans sa manche plusieurs cartes pour tenter de faire plier notre île, même s'il lui faut la dépeupler en la privant des jeunes hommes et des jeunes femmes auxquels il propose les miettes des biens et des ressources qu'il pille partout dans le reste du monde.
Que les porte-parole de l'Empire expliquent maintenant comment et pourquoi l'apartheid vit le jour !


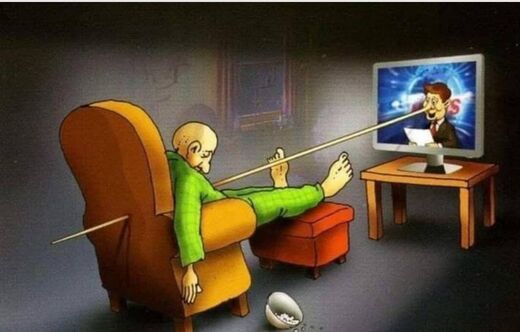

Commentaires des Lecteurs
Lettre d'Information