Concernant la fabrique de son histoire et de son identité nationale, force est de constater qu'Israël est un pays comme les autres. Elle fonctionne sur une série de mythes constitutifs. La différence principale entre Israël et les autres États tient sans doute au temps court qui sépare sa fondation de la période actuelle qui nous permet d'observer, peut-être plus facilement, les mécanismes historiographiques et la construction narrative à l'œuvre.
Parmi ses mythes fondateurs, celui d'une Palestine « vide de Palestinien.ne.s » : le mythe de la terre vierge, déjà énoncée en 1901 par Israel Zangwill à qui on attribue la désormais célèbre phrase : « Une terre sans peuple pour un peuple sans terre » est tenace et a, un temps d'ailleurs, été repris par une partie des universitaires à l'étranger. Ainsi, dans une ancienne version (1980, actualisée depuis) du Que-Sais-Je? consacré au sionisme, ses auteurs n'hésitent pas à écrire que :
« La partie occidentale de la Palestine (que recouvre le territoire actuel de l'État d'Israël) constituait jusqu'à la fin du 19ème siècle une terre en grande partie vide et presque entièrement désertique (...) Contrairement à un mythe solidement enraciné depuis peu, la Palestine occidentale était encore, il y a une centaine d'années, largement inhabitée. Aucune population arabe d'importance n'y vivait alors (...) » (1).C'est faire bien peu de cas des réalités démographiques puisque le dernier recensement britannique pour les Nations unies estime qu'en 1946, sur une population totale de 1 845 560 habitant.e.s, on comptait 58,35% de musulman.e.s (1 076 780 hab.), 32,95% de juif.ve.s (608 230 hab.) et 7,85% de chrétien.ne.s (145 060 Arabes Palestinien.ne.s et non Arabes) (2).
La façon dont la terre « vide » aurait, cette fois, été vidée, est un autre mythe tenace sur laquelle la mémoire collective juive israélienne s'est bâtie : celui du départ « volontaire » des Palestinien.ne.s en 1948. Selon le récit commun, l'histoire est simple : l'Holocauste, la reconnaissance par la communauté internationale d'un foyer dans lequel le peuple juif pourrait vivre en sécurité, le plan de partition proposé par les Nations unies, le refus des négociateurs arabes, le déclenchement de la guerre, la victoire, l'indépendance, l'Etat juif.
Le territoire alloué au futur État juif par le plan de partition, étendu sur 14 000 kilomètres carrés et formé de trois zones (la quasi intégralité du littoral, la région du lac de Tibériade jusqu'à la frontière syrienne et la majorité du Negev) représentait 55% de la Palestine historique, dans laquelle résidaient entre 900 000 et 1 million de Palestinien.ne.s avant la guerre de 1948. Au sortir de la guerre, il n'en restait que 150 000. Pour la majorité des Israélien.ne.s, ce qui explique cette baisse significative de la population arabe-palestinienne du pays est simple : leur dirigeants leur ont donné l'ordre de quitter leurs villages pour se réfugier à l'abri le temps que la guerre soit réglée ou ils ont fui par peur. Il est vrai que beaucoup, alors, pensaient que le déplacement ne serait que de courte durée. Et effectivement, personne n'aurait pu croire qu'un déplacement de 750 000 personnes aurait pu perdurer jusqu'aujourd'hui.
Le mot « Nakba » est un terme arabe qui signifie « catastrophe » ou « cataclysme ». Il désigne l'expulsion de 750 000 Palestinien.ne.s de leur terre d'origine, la destruction de près de 600 communautés et de la très grande majorité de la vie palestinienne.
Israël est, disions-nous au début de ce texte, comme bien d'autres puissances coloniales : elle possède ses zones d'ombres, une histoire effacée, niée, enfouie et une histoire officielle savamment mise en scène. Ainsi, 1948 n'est pas l'année de la « Nakba » et de la catastrophe mais celle de « l'Indépendance » et de la renaissance. Or, s'il y a 15 ans, le mot « Nakba » n'existait pas en hébreu, le terme a désormais - et grâce au travail acharné d'une poignée d'activistes - intégré le vocabulaire commun. Ainsi les fans du club de football Hapoel Tel Aviv ont-ils parlé de « véritable Nakba » lorsque leur stade historique a été détruit ou le chroniqueur sportif d'une radio de parler d'une « Nakba » pour demander si les conflits au sein d'une équipe de football s'envenimaient.
Rentré dans le langage commun ne signifie bien sûr pas pour autant que les Israélien.ne.s savent réellement ce qu'est la Nakba. Dans le cadre d'une des recherches que nous menons au sein de De-Colonizer, nous avons effectué une enquête scientifique auprès de 500 juif.ve.s israélien.ne.s et réalisé un documentaire pour lequel nous sommes partis à la rencontre de ces Israélien.ne.s leur demander ce qu'elles/ ils savaient réellement de la Nakba. Pour beaucoup, il s'agit d'un évènement qui a « quelque chose à voir avec les Arabes » : est-ce une fête arabe? Un soulèvement? (confondant ainsi Nakba et Intifada). Peu sont réellement capables de dire ce que recouvre le terme ou proposent une définition conflictuelle. Et il n'est pas surprenant qu'il en soit ainsi, nulle mention de la Nakba dans les programmes scolaires, interdiction de la commémorer le jour de la fête de l'indépendance et même une ministre de la culture qui déclare en 2014, tentant de faire interdire un festival de film autour de la Nakba à la cinémathèque de Tel Aviv, au motif qu'il n'est « pas normal que soit faite la promotion d'une notion négative se référant au jour de l'établissement d'Israël ». Son collègue Gideon Saar, alors ministre de l'éducation, abonde dans le même sens arguant qu'enseigner la Nakba à l'école reviendrait à dire que « la fondation d'Israël est un désastre ». La Nakba est donc naturellement devenue « la façon dont les Arabes définissent notre Indépendance, la fondation de notre État », c'est leur « Jour de la Nakba ».
L'idée selon laquelle la Nakba est un jour où les Palestinien.ne.s commémorent l'établissement d'Israël est non seulement erroné (la « Nakba » se réfère à l'expulsion et à la destruction de la majorité des communautés palestiniennes, à un épisode historique à replacer dans un continuum historique et un projet colonial, et pas à la création d'un État) mais renforce l'idée majoritairement répandue selon laquelle l'identité palestinienne se réduirait à une détestation des Juifs et d'Israël. Le contexte permanent de tensions et le cycle ininterrompu de violence depuis 1948 achève de polariser les identités : c'est « eux » contre « nous », « leur » retour signifierait « notre » fin.
Et l'intérêt est fort à maintenir ce conflit définitionnel : continuer à présenter la commémoration de la Nakba comme celle de « leur » libération ne permet pas aux Israélien.ne.s de prendre leurs responsabilités dans ce qui s'est passé. Effectivement, comment penser que « notre » propre existence est « leur » catastrophe ? Se contenter d'établir que la Nakba est le drame de la fondation d'Israël et non revenir à sa définition réelle ne permet pas de regarder cette histoire comme une catastrophe humaine arrivée à une partie de la population mais la cantonne à « quelque chose contre nous ». C'est non seulement nier la catastrophe et le traumatisme de l'autre mais c'est également les détourner pour en faire un objet de conflit et de peur. Restituer à la Nakba sa définition réelle permettrait de développer l'empathie ou la compréhension : s'ils n'étaient pas sommés de choisir entre eux eux-mêmes et les autres, beaucoup pourraient sans doute comprendre les souffrances endurées. Mais comme le résumait une des personnes que nous interrogions dans les rues de Tel Aviv : « C'est leur histoire, ce n'est pas notre problème ».
Nous pensons, au contraire, que la Nakba n'appartient pas uniquement à l'histoire palestinienne : c'est aussi une partie, douloureuse certes, de l'histoire israélienne et de toutes celles et ceux qui habitent la région. Dire que la Nakba ne serait que « leur » problème reviendrait à dire qu'un séisme au Népal n'est l'affaire « que » des Népalais ou que l'Holocauste est uniquement l'histoire des Juifs. Accepter de prendre une responsabilité dans les évènements de 1948, c'est regarder les zones d'ombre de l'histoire et admettre qu'il faut envisager des réparations pour pouvoir accéder à la paix, c'est imaginer et repenser le vivre ensemble.
Et si les activités de commémoration de la Nakba se déroulent autour du 15 mai, ce n'est pas tant par symbole que par contrainte : de 1948 à 1966, les citoyen.ne.s Palestinien.ne.s en Israël furent soumis à un contrôle militaire. Le jour de la fête de l'indépendance (autour du 15 mai, la date changeant chaque année puisqu'elle se réfère au calendrier hébreu et non au calendrier romain) était le seul jour où les Palestinien.ne.s resté.e.s dans les frontières de l'État d'Israël étaient autorisé.e.s à se déplacer librement, c'est-à-dire sans permis, et pouvaient ainsi se rendre dans leurs villages d'origine d'où ils avaient été déplacés. Après les accords d'Oslo, les réfugiés en diaspora mais également ceux d'Israël comprirent que leur droit au retour ne figurait pas dans l'agenda politique d'un accord sur deux États. Les commémorations de la Nakba prirent alors une dimension éminemment plus politique : se souvenir de la catastrophe publiquement le jour de l'indépendance.
Depuis, les commémorations de la Nakba en Israël se déroulent principalement autour de cette date et depuis 2002, des citoyens juifs israéliens ont commencé à se joindre aux commémorations mais jusqu'en 2012, elles restaient circonscrites aux sphères politiques ou publiques palestiniennes. Pour la majorité des Israélien.ne.s, le « Jour de la Nakba » est un jour de révolte en Cisjordanie et sur les plateaux du Golan au cours duquel « les réfugiés tentent de revenir ».
2012 marque un tournant. Pour la première fois, une commémoration publique, initiée par des étudiants juifs et palestiniens, est organisé à l'université de Tel Aviv, au cœur d'un symbole fort de l'espace public israélien. Les médias s'emparent alors de l'évènement qui est un véritable camouflet pour le gouvernement : on commémore la Nakba dans une université israélienne et ce, malgré la loi l'interdisant (2011). La semaine précédant la cérémonie, l'université est soumise à de fortes pressions, le gouvernement allant même jusqu'à menacer de couper une partie de son budget. Mais malgré la pression, malgré une (petite) mobilisation de la droite et l'extrême droite israélienne : la cérémonie a lieu. Et cette cérémonie est organisée selon un modèle bien précis destiné à marquer les esprits et à permettre une identification, si ce n'est une empathie, du public juif. Elle débute par la lecture d'un texte qui n'est pas sans rappeler le traditionnel Yizkor (une prière récitée à la mémoire des disparu.e.s et qui signifie « Qu'il se souvienne ») et s'achève par une minute de silence.
« Nous, Juifs et Arabes, nous réunissons aujourd'hui pour commémorer la catastrophe palestinienne, la Nakba. Pour se rappeler de ceux qui furent tués, expulsés de leur village, qui ont fui pour survivre et qui ne sont pas autorisés à revenir chez eux, ceux qui sont devenus des réfugiés sur leur propre terre ou dans des camps. Aujourd'hui, nous commémorons 64 ans de douleur et de silence (...) le piétinement des droits de ceux qui sont présents et ceux qui sont absents (...) C'est cette catastrophe qui a mené à l'état de guerre permanent dans lequel nous vivons (...) Puisse le Peuple Juif se souvenir. Puisse le Peuple Palestinien se souvenir. Puissions-nous tous nous souvenir. »Cette cérémonie est sans doute un des évènements les plus marquants de l'histoire de la lutte contre le déni et pour la mémoire de la Nakba en Israël. Depuis, y compris quand il s'agit de la nier ou de s'y opposer, la Nakba est devenue le point de référence historique à partir duquel il faut se positionner. La Nakba est devenu le curseur des positionnements politiques : il est très clair que la gauche israélienne est désormais divisée entre les « modérés » qui continuent à se référer à l'occupation de 1967 comme étant le problème, et une autre partie de la gauche, de plus en plus nombreuse, qui comprend que les racines de la situation actuelle remontent à 1948. A droite aussi, ils sont de plus en plus nombreux à comprendre que le problème est 1948 et les conditions mêmes de l'établissement de l'État d'Israël. Preuve en est de leur acharnement à combattre la Nakba, c'est bien là que le bât blesse.
Notes :
(1) C. Franck et M. Herszlikowicz (1980), Le sionisme, Presses Universitaires de France, coll. Que Sais-Je?, p.8-9.
(2) Nations Unies, document A/AC.25/W/4 (classifié le 22 mars 1949)


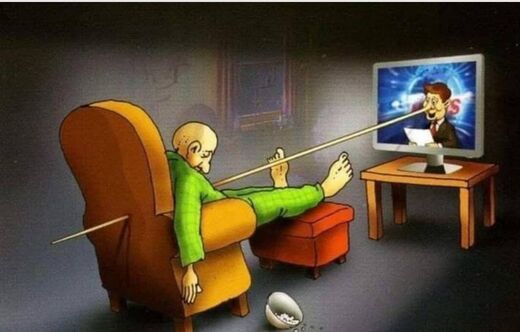

Commentaires des Lecteurs
Lettre d'Information