DE LA CONTRE-CULTURE AU NATIONALISME BLANC
Né en 1944, MacDonald appartient pleinement à la génération de la « contre-culture », celle qui, à partir du début des années 1960, favorisa de façon décisive le travail de sape entamé de longue date contre l'Amérique blanche et qui visait à déposséder peu à peu les Américains d'origine européenne de leur prédominance politique et culturelle. Initialement enclin à sympathiser avec ses condisciples de la gauche radicale, MacDonald, alors étudiant à l'Université de Madison (Wisconsin), n'en fut pas moins frappé par la surreprésentation des Juifs parmi les agitateurs ainsi que par leur façon typique d'imposer un pilpoul permanent autour des interprétations de Marx.
Mais, désireux de poursuivre des études supérieures dans le domaine de plusieurs sciences « dures » (biologie moléculaire, génétique des populations, éthologie, sociobiologie, etc.), il fit ensuite une brillante carrière scientifique, et non politique, au point d'être considéré aujourd'hui comme l'un des plus importants représentants de la psychologie évolutionnaire. On désigne sous ce nom plutôt barbare une discipline apparue dans les années 1980 et qui entend expliquer les mécanismes de la pensée humaine à partir de la théorie de l'évolution. En reprenant l'idée selon laquelle l'évolution de l'humanité dérive plus d'une rivalité entre groupes que d'une rivalité entre individus, la psychologie évolutionnaire n'est pas abstraitement séparée de l'histoire. En effet, elle se sert notamment de la notion de « stratégie de groupe » pour étudier des catégories humaines larges, qui peuvent aller jusqu'à des peuples.
Devenu, selon ses propres termes, « un universitaire plus ou moins conservateur », MacDonald n'était donc pas vraiment prédisposé à jouer un jour le rôle qui est le sien depuis plus d'une décennie maintenant, à savoir celui de principale tête pensante du mouvement nationaliste blanc aux États-Unis. Mais il est définitivement sorti du carriérisme prudent en appliquant les méthodes, données et critères de sa discipline à l'étude de l'histoire et de l'action du peuple juif. Cela lui vaut aujourd'hui une notice de plus de dix pages sur le site de la plus célèbre organisation juive américaine, l'Anti-Defamation League, qui le qualifie de « professeur antisémite de psychologie évolutionnaire1 », comme si l'antisémitisme supposé de MacDonald ôtait toute valeur à son magistère scientifique. Il s'agit en réalité de faire admettre une bonne fois pour toutes, n'en déplaise à l'histoire des sciences, qu'un grand scientifique ne peut pas être un antisémite et qu'un antisémite ne peut pas être un grand scientifique.
LE « SIÈCLE JUIF » ET LE PRÈTENDU « UNIVERSALISME MORAL »
Ce qui dérange profondément dans le cas de MacDonald, c'est que celui-ci ne s'est en rien départi de la forme du discours scientifique lorsqu'il est passé de ses travaux hautement spécialisés à l'étude de la question juive. Chez lui, le ton est dépassionné, la polémique totalement absente, l'appareil de notes toujours impressionnant, les sources juives faisant autorité abondamment sollicitées, la grande majorité des références renvoyant d'ailleurs à des ouvrages universitaires. Ces caractéristiques sont vraiment la marque de fabrique des trois essais composant la « trilogie juive » de l'auteur américain - un livre, paru en 1994, sur le judaïsme comme stratégie de groupe comparé à d'autres peuples « diasporiques » (Tsiganes, Chinois d'outre-mer, etc.) ; une tentative de définition d'une théorie évolutionnaire de l'antisémitisme, qui remonte à 1998 ; et, la même année, un essai sur la formidable implication juive dans les courants intellectuels et politiques du XXe siècle - et d'un gros recueil d'articles, Cultural Insurrections, paru en 2007. Trois des quatre brochures dont on va s'occuper ici sont en fait de longs articles empruntés à ce recueil, la quatrième, celle sur le national-socialisme et le judaïsme, qui est aussi la plus importante, étant la traduction d'un chapitre du deuxième volume de la « trilogie juive ».
Dans Les Bourreaux volontaires de Staline - titre emprunté par MacDonald à l'auteur du livre qu'il analyse, mais qui est évidemment une réplique cinglante à la formule de Daniel Goldhagen accusant les « Allemands ordinaires » d'avoir été « les bourreaux volontaires de Hitler » - , MacDonald tombe d'accord avec un auteur juif qui a caractérisé le XXe siècle comme le « siècle juif » par excellence2 et dont l'ouvrage est selon lui « sans doute la meilleure source et la plus à jour que nous possédions sur la prééminence économique et culturelle juive en Europe (et en Amérique)3 ». Plus particulièrement, MacDonald démontre de manière convaincante que, tout au long du siècle passé, les extrémistes de gauche juifs, en Pologne, aux États-Unis et partout ailleurs, n'avaient aucunement renoncé, la plupart du temps, à leur judéité, allant même dans certains cas, sur la base de leur messianisme métamorphosé mais non abandonné, jusqu'à donner un contenu politique révolutionnaire à certaines fêtes religieuses juives.
Avec L'Activisme juif et ses traits essentiels, c'est plutôt sur la psychologie juive que se penche MacDonald. Selon lui, l' « hyperethnocentrisme » est inscrit dans le code génétique du peuple juif et dérive lointainement des origines proche-orientales de celui-ci, avec tout ce que cela implique : pratiques maritales endogamiques, formes de socialisation insistant sur l'identification au groupe d'appartenance, obligations envers la parenté élargie, etc. La vraie morale juive se résumerait donc dans la formule « Est bon ce qui est bon pour les Juifs ». Quant au prétendu « universalisme moral » des Juifs et à leur façon - tantôt sincère et relevant de l' « auto-aveuglement », tantôt soigneusement calculée - de se concevoir comme une communauté porteuse d'une éthique altruiste et chargée de la rédemption des Gentils, il est consciencieusement démoli par MacDonald, qui l'interprète comme un « habillage idéaliste » destiné à masquer les vrais conflits d'intérêts entre Juifs et autochtones.
En décortiquant littéralement un classique de l'antisémitisme - la série d'articles parus entre 1920 et 1922 dans un journal financé par l'industriel Henry Ford et réunis ensuite sous le titre Le Juif international - , MacDonald revient notamment sur l'une des armes préférées du judaïsme comme stratégie de groupe : se faire passer pour une simple communauté religieuse, alors même que selon les données les plus fiables de la génétique des populations les Juifs constituent bien un peuple voire une race au sens de « groupe ethnique ». À ce sujet, MacDonald cite un ouvrage paru en 1986, consacré à l'émancipation des Juifs et écrit par un grand historien du judaïsme, Jacob Katz, lui-même juif : « [Dès] le début, la définition de la communauté juive comme une entité exclusivement religieuse fut, bien sûr, une feinte4. »
TRADITION VÖLKISCH ET « RACIALISME SIONISTE » : DES SIMILITUDES ?
Mais c'est sans conteste avec son étude sur les rapports « spéculaires » du national-socialisme et du judaïsme, l'un étant interprété comme le miroir inversé de l'autre, que MacDonald fait le plus œuvre novatrice. En revisitant, d'une part la tradition intellectuelle völkisch, d'autre part le courant de ceux qu'il nomme « les racialistes scientifiques sionistes », MacDonald réunit de façon éblouissante les preuves permettant de « soutenir que, durant la période précédant le national-socialisme et à l'instar de leurs ennemis spéculaires, beaucoup d'intellectuels juifs défendaient une conception fortement raciale du peuple juif et croyaient à la supériorité dela "race" juive5 ». Mais il illustre aussi avec une rigueur et une érudition impeccables l'évolution parallèle des positions dans les deux camps. En effet, du côté du judaïsme on assiste au lent déclin du mouvement réformateur des Juifs libéraux, au profit de l'ostentatoire nationalisme ethnocentré des sionistes, qui apparaît avant, et non pas après, le développement de l'antisémitisme, MacDonald soulignant avec Katz, de nouveau, que « le XIXe siècle commença avec la bénédiction donnée aux assimilationnistes juifs lors du Sanhédrin de Paris réuni par Napoléon en 1807 et s'acheva avec le premier Congrès sioniste de Bâle, en 18976 ». Dans le même temps, l'antisémitisme allemand passe, lui, des exigences d'assimilation de la minorité juive à une insistance croissante sur le clivage ethnique, notamment dans la seconde partie du XIXe siècle, lorsque le darwinisme social prend une inflexion bien particulière en Allemagne, avec l'idée - étrangère au courant majoritaire, anglo-saxon, du darwinisme - selon laquelle la pureté raciale d'un groupe est une condition indispensable au succès de ce groupe.
Dès lors, la stratégie de groupe juive, tout en étant combattue, devient un modèle à suivre. L'un des antisémites völkisch les plus influents, Theodor Fritsch (dont Adolf Hitler fut un grand lecteur), exhorte les Allemands à faire preuve d'une solidarité de groupe aussi forte que celle des Juifs. Et un auteur aussi important, à l'époque, que H. S. Chamberlain, littéralement vénéré par Hitler, Rosenberg et Goebbels réunis, écrit par exemple dans son œuvre majeure :
« Les Juifs méritent l'admiration, car ils ont agi avec une absolue sûreté selon la logique et la vérité de leur être, et jamais le verbiage humanitaire (auquel ils ne se sont associés qu'autant qu'ils y trouvaient avantage) ne leur a fait oublier un seul instant la sainteté des lois physiques7. »CEUX QUI VENDENT LA MÈCHE
On a vu que MacDonald cite très volontiers de nombreux auteurs juifs tout ce qu'il y a de plus sérieux, qui se félicitent ouvertement, à l'instar de Slezkine, de la judaïsation de notre monde, la trouvant seulement, parfois, encore insuffisante. Son œuvre a donc aussi le mérite de nous rappeler que, contrairement à ce que pensent beaucoup de conspirationnistes, il n'y a pas de secret qui ne puisse être dévoilé en dernière analyse, et ce pour la bonne et simple raison que, parmi les intéressés qui tirent les ficelles, il s'en trouve toujours trop, poussés par l'orgueil et l'arrogance, pour vendre la mèche. Encore faut-il, tel un MacDonald, avoir les moyens et la persévérance d'aller chercher l'information là où elle se trouve, dans des ouvrages qui ne sont généralement pas destinés au grand public, puis la capacité de l'interpréter comme il convient.
Ainsi donc, Slezkine, parce qu'il est juif et parce qu'il s'en félicite, a le droit de caractériser le XXe siècle comme « le siècle juif ». Mais MacDonald, qui est un goy et qui soutient que la « culture de la critique », autre nom de la culture juive au XXe siècle, est responsable de la « pathologisation » des fidélités traditionnelles à la race, à la nation, à la religion et à la famille, avec pour conséquence « l'idée que l'ancienne majorité dominante d'origine européenne [aux États-Unis, mais ce discours pourrait bientôt s'appliquer à tout l'Occident] a l'obligation morale de se résoudre à sa propre éclipse démographique et culturelle8 » - MacDonald, donc, n'est plus, en dépit de tous ses titres, qu'un affreux antisémite à reléguer en marge de la culture officielle. Un cas comme le sien nous livre très précisément la mesure du pouvoir juif aujourd'hui sur la mentalité collective : de même qu'il est interdit de contester la modernité dans son principe même car elle est réputée ne faire qu'un avec l'aboutissement de la civilisation proprement dite, ainsi il est interdit de souligner la formidable contribution juive à la construction de la modernité, sauf si l'on est soi-même d'origine juive et sauf si l'on approuve cette contribution. C'est ce qu'avait résumé avec humour et ironie, il y a déjà un demi-siècle, Wilmot Robertson (1915-2005), autre grande figure intellectuelle du mouvement nationaliste blanc : « Dans l'Occident contemporain - écrivait-il - ,on ne peut être vraiment objectif sur les Juifs que si l'on est juif9. »
On laissera le mot de la fin à un expert, l'essayiste franco-anglo-américain George Steiner, fils de Juifs viennois. Autrefois fréquemment invité par Bernard Pivot dans le cadre de l'émission « Apostrophes », Steiner est un critique littéraire au goût très sûr, puisqu'il considère Les Deux Étendards de Lucien Rebatet comme l'un des plus grands romans du XXe siècle. En 1980, Steiner pouvait écrire avec une satisfaction tranquille dans les colonnes du New Yorker, ce temple du judaïsme intellectuel où s'illustra avant lui la brillante Hannah Arendt, l'auteur préféré d'Alain Finkielkraut : « Tout ce qui fait la pulpe de la modernité urbaine, tout ce qui lui donne son piquant, on peut dire que ce sont avant tout le judaïsme et l'homosexualité qui l'ont fait naître (et d'autant plus vivement quand les deux s'y sont mis à la fois, comme chez un Proustou chez un Wittgenstein)10. »
Pour ne pas mourir idiots, pour n'être plus dupes de rien, lisez Kevin MacDonald. Sa thèse centrale est strictement irréfutable. Comme l'a pressenti son éditeur français, qui a choisi des couvertures sobres et élégantes, celles qui conviennent aux très grands, cet auteur américain est destiné à devenir un véritable classique.
Kevin B. MacDonald, Les Bourreaux volontaires de Staline.Les Juifs, une élite ennemie en URSS, 2010, 79 p., 12 € ; L'Activisme juif et ses traits essentiels, 2011, 79 p., 12 € ; Henry Ford et la question juive, 2012, 65 p., 12 € ; Le National-socialisme. Une stratégie évolutionnaire et antijuivede groupe, 2012, 107 p., 15 €.
Tous aux éditions Pierre Marteau (diffusion Akribeia - 45/3 route de Vourles - 69230 Saint-Genis-Laval). Frais de port : 3 € par brochure, 5 € seulement pour toute commande des quatre brochures


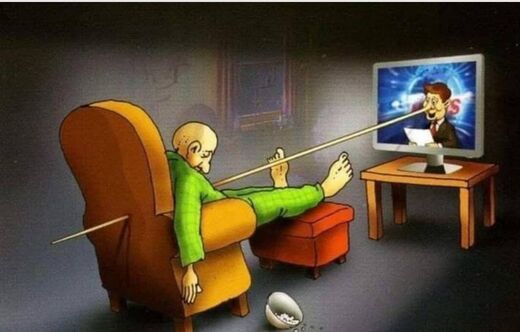

Commentaires des Lecteurs
Lettre d'Information