Les récits qu'ils font de ces rencontres, souvent publiés dans la presse à grand tirage, forment un genre à part entière : celui du voyage en dictature. C'est à lui que se consacre ici Alexandre Saintin. Décrivant les ressorts diplomatiques de ces rencontres et les enjeux de carrière qu'elles pouvaient servir, il montre que ces voyages traduisent avant tout la fascination de ces intellectuels pour l'autorité et pour les chefs charismatiques, dont ils estimaient alors la France dangereusement dépourvue.
« Mussolini est plus grand que son temps. Tel, je l'ai vu, en 1932, aux fêtes et réceptions, publiques et privées, d'un congrès romain, tel, je le retrouve dans les pages de Massis, robuste et simple, toujours en direct dans ses propos. [...] Il n'a jamais été, comme Hitler, l'interprète d'un délire. Il a été l'éducateur, le père de son peuple [1]Séduction contre distanciation, sympathie contre répulsion : telle fut la distinction opérée par Daniel Halévy qui rencontra trois fois le Duce en 1932. Sa position résume-t-elle celle de tous les intellectuels français partis à la rencontre des dictateurs d'outre-Rhin et d'outre-Monts ?
Au cours des déplacements réalisés par les intellectuels français dans l'Europe brune et noire, des formes surgissent de manière récurrente dans la littérature de voyage, en constituent des motifs distinctifs et essentiels. Figure anthropologique de l'altérité et produit du nouveau régime, l'Italien ou l'Allemand incarne un exotisme politique aux yeux du visiteur français. Cependant, ces rencontres ne produisent pas toujours une science précise de l'objet étudié. Ainsi, au terme de son voyage, le socialiste Daniel Guérin usait du terme de « cacophonie » allemande : celui qui avait voulu voir l'Allemagne de la fin de 1932 n'y entendait concrètement plus rien. Si les intellectuels français voyagent pour voir et rapporter ce qu'ils ont vu, il semble que certains motifs s'imposent dans leurs récits. Ainsi, le passage de la frontière et la rencontre des jeunesses allemande ou italienne viennent rapidement heurter les représentations des intellectuels en voyage. Mais c'est à la rencontre des dictateurs, incarnant le régime, que nous voudrions nous intéresser.
Cette figure du dictateur s'impose très fréquemment dans les narrations des voyageurs au point d'en devenir des topos incontournables. Dominant l'organisation des pouvoirs en Italie comme en Allemagne, le Duce et le Führer captent l'attention des visiteurs français. Voir la figure du chef devient l'acte par lequel passe toute compréhension de la destinée des mouvements fascistes. Cette rencontre est un prisme cognitif. L'esthétisation du politique au sein des régimes totalitaires passe en priorité par la mise en scène du corps et du visage du chef, que nombre de voyageurs veulent scruter, éventuellement toucher. Dès lors, les récits mentionnent les éléments de présence visible du chef. En plus des réalisations concrètes de sa volonté, ils se montrent attentifs aux traces symboliques de son pouvoir. Certains voyageurs obtiennent par ailleurs des audiences, des possibilités d'entretien, de manière très inégale selon le dictateur, d'autant que Mussolini maîtrise le français, mais pas Hitler. Plus accessibles, d'autres piliers du régime accordent un entretien aux intellectuels français, désireux de trouver une autre incarnation du pouvoir fasciste ou nazi, voire d'identifier le successeur du tyran.
Nous usons ici du terme d'intellectuels pour désigner des écrivains, des reporters partis à la rencontre des dictateurs : toutefois leurs récits ne constituent pas leur acte de naissance en tant qu'intellectuels. Ayant déjà publié textes et ouvrages avant ce voyage en dictature, ces voyageurs bénéficient d'une réputation en France comme à l'étranger. Cette fama, associée à l'action des réseaux d'entente bilatéraux, tels les Comités France-Italie (1931) et France-Allemagne (1935), auxquels appartiennent nombre des auteurs cités ici, permet d'ouvrir les portes de la chancellerie allemande ou du palais Chigi.
Élites, diplômés, groupes de créateurs, intervenant dans les questions publiques donc politiques, définissant une relation génétique avec les cercles du pouvoir dans une perspective de légitimation réciproque, ces intellectuels forment une catégorie dont la délimitation ne passe pas par ses statuts, mais par son action, « son intervention sur le terrain du politique [2] Provenant des sphères culturelles pour devenir producteur ou consommateur d'idéologie, l'intellectuel pense et communique sa pensée : le récit de voyage, sous la forme assumée du reportage, devient le support médiatique de cette dernière. Il propose ainsi une revendication et un essai sur un sujet contemporain : les régimes nouveaux de l'Italie et l'Allemagne, et, en filigrane dans nombre de récits, le meilleur régime politique pour la France.
Mus par un intérêt personnel ou professionnel, ces intellectuels partageaient en majorité un anticommunisme public auquel s'ajoutait parfois un antiparlementarisme vigoureux. Les médias, pour lesquels ils rapportent leurs entrevues, sont en quasi-totalité d'obédience conservatrice. Autant de qualifications leur permettent d'interroger les parcours des dictateurs, de s'intéresser à l'homme fort et d'en obtenir un entretien.
Lorsque nous établissons une brève typologie de ces intellectuels voyageurs, nous observons la forte représentation d'apologistes des régimes fasciste et nazi : ainsi les écrivains Paule Herfort, Blandine Ollivier ou Daniel Halévy n'ont pas cessé de louer, plus ou moins subtilement, les qualités de dirigeant de Mussolini. Appartenant à la génération de la Grande Guerre (pour l'avoir faite ou l'avoir vécue), tous n'ont pas la même surface médiatique : leurs articles sont publiés dans des quotidiens nationaux à grand tirage, dans des hebdomadaires culturels ou des revues conservatrices. Un nombre important de ces intellectuels rassemblèrent leurs articles pour les éditer en recueils, comme Blandine Ollivier chez Gallimard (Nrf), Paule Herfort aux Éditions de la Revue mondiale, Daniel Halévy chez Grasset.
Les voyageurs en hitlérie sont pour partie devenus collaborationnistes pendant la Seconde Guerre mondiale : si le journaliste Philippe Barrès devint gaulliste (puis partisan de l'Algérie française), l'écrivain Alphonse de Châteaubriant et le journaliste Fernand de Brinon furent membres du Comité France-Allemagne avant guerre, puis du groupe Collaboration pendant le conflit, pour finir aux côtés des nazis durant la débâcle. Passée l'épuration, les affinités électives de ceux-ci se poursuivent lorsque, par exemple, les écrivains Daniel Halévy et Bertrand de Jouvenel signent leurs chroniques dans le Courrier français, un mensuel royaliste (1948-1950), antiparlementaire. La journaliste et décoratrice Suzanne Bertillon, le Goncourt (1927) Maurice Bedel et le futur résistant Pierre Scize font partie des rares contempteurs des dictateurs, même si au cœur des critiques percent ça et là une forme d'admiration ou la reconnaissance d'un savoir-faire propagandiste. Cependant, s'ils en ont esquissé des portraits, ces derniers n'ont jamais obtenu au cours de leur voyage d'entretien direct avec les leaders fasciste et nazi. De façon générale, les revues ou quotidiens nationaux dépêchent des reporters chevronnés, tels Jules Sauerwein, Claude Blanchard (prix Albert Londres 1935) ou Henri Béraud, incarnant la figure archétypale de l'écrivain-reporter [3] Forts de cette renommée, ces derniers sont donc plus envoyés officiels, et reçus comme tels, que baroudeurs forçant le passage pour obtenir une entrevue « exclusive » du chef d'État.
Au fil de leur séjour allemand ou italien, ces intellectuels français n'échappent pas à une des interrogations principales de leur temps : celle de l'autorité politique. Questionnant le vide occupant le centre de leur démocratie - régime dont le corps d'aucun chef n'incarne l'autorité [4], ces intellectuels participent à la recherche d'un principe et d'une incarnation de la conduite politique. Cette recherche ne fut pas spécifiquement française, puisqu'en Allemagne Max Weber et Leopold von Wiese proposèrent dès 1918 une sociologie de la domination charismatique. Elle répondait à des inquiétudes : celle de la perte des hiérarchies traditionnelles, ou celles nées des questionnements de 1918. Depuis Gustave Le Bon, concentrée sur les questions de commandement et d'une figure autoritaire après 1918, la littérature française abonde en références sur les rapports entre masses et élites [5] qu'une « nécessité de chefs est formulée [6]» durant l'entre-deux-guerres, de l'armée à l'entreprise en passant par l'administration, écoles et instituts mettent en œuvre des recherches sur la psychologie et les pratiques de l'autorité. On retiendra de cette période qu'elle fut celle où la « société française est aux prises avec l'autodiagnostic du déficit d'autorité [7] ». Le principe de l'incarnation du pouvoir par un chef s'articule à un ensemble de valeurs et de méthodes, comme celles de l'ordre et de la révolution. Dès lors, voir la figure d'un chef au cœur des expériences révolutionnaires italienne et allemande semble constituer un moteur essentiel des voyages de ces intellectuels : pour mieux cerner les qualités innées et la dimension volontariste, auto-édificatrice, du chef (celui dont la France aurait besoin), il leur fallait rencontrer le type humain de l'autorité politique, incarné dans des figures spécifiques à l'Italie fasciste et à l'Allemagne nazie.
Ces récits deviennent ainsi des outils de compréhension du schéma totalitaire mais également un prisme d'étude de la fascination française pour l'autorité en politique.
Nécessités de la rencontre du dictateur
Comment échapper à l'œil et à la voix du dictateur ? Défi impossible du voyageur français. En titres des récits de voyage, l'Italie est mussolinienne, l'Allemagne comme sa jeunesse prennent l'épithète de hitlérienne. Le chef de la nouvelle Allemagne est partout, dans les films, à la radio, sur les affiches, à l'occasion des plébiscites davantage encore, dans les cafés, les restaurants, en portrait au côté de Hindenburg surplombant les clients, son nom apposé sur les tracts largués par avion. Les discours de Hitler rassemblent la population de Neubabelsberg en 1934 dans un studio de cinéma apprêté aux couleurs et symboles du pouvoir, et la parole du chef se diffuse depuis un haut-parleur encadré de deux miliciens. En 1936, à l'occasion du plébiscite, du Rhin à Memel, de la Baltique aux Alpes bavaroises, dans les villes, les villages, les campagnes, partout la même scène se produit devant les yeux de l'écrivain français Georges Imann :
« Drapeaux, paroles inscrites, des millions d'êtres prononcent le même nom [...]. Obsédé, comment ne le serait-on pas, en effet, alors que, dès Aix-la-Chapelle, la première locomotive que l'on croise porte, peint en grandes lettres sur son tender : "Ton honneur, ta fidélité au Führer" [8] »Lors des grandes messes de Nuremberg, en 1937, auprès des stands de nourriture à emporter, voisinent « le portrait de Monsieur Hitler souriant, sévère, rêveur, inspiré, murmurant, parlant, criant, de Monsieur Hitler en casquette, en mèche, en chapeau mou, avançant le bras, élevant la main, mettant ses gants, les ôtant, ne sachant qu'en faire [...] de Monsieur Hitler marchant à toutes bottes entre cent mille hommes à sa gauche et cent mille hommes à sa droite, marchant en silence sous les sapins de Berchtesgaden [9][9]Maurice Bedel, Monsieur Hitler, Paris, Gallimard, 1937, p. 20.... » Kaléidoscope du tyran.
13Dans la péninsule italienne, Mussolini a son portrait sur les objets, sur des mouchoirs brodés [10][10]Henri Jeanson, « Au pays des chemises noires : dans Rome..., dans les vitrines des magasins, au recto des cartes postales, aux murs décorés des villes par les slogans « Eviva il Duce », ou la devise fasciste du « Croire. Obéir. Combattre »... tout est support des traits du Duce. Maurice Bedel écrit :
14
« Ce masque [...], on se heurte à lui de quelque côté que l'on se trouve, dans les salles de rédaction, chez le confiseur, chez le perruquier, dans les cabines téléphoniques, chez le marchand de tabac [11][11]Maurice Bedel, Fascisme an VII, Paris, Gallimard, 1929, p. 9.. »1Ouvrier, sportif, paysan, Mussolini possède mille visages que la propagande relaie abondamment, captée par les récits des voyageurs français. Omnipotent, il est également omniscient, et l'écrivain Henri Béraud le compare pour cela à un dieu, dont l'œil s'affiche partout et suit en tous lieux le visiteur [12) Les voyageurs prirent conscience rapidement de cette « domination charismatique » [13] et, dès la frontière passée, que le Duce ne tolérait pas de concurrence. Les mises à l'écart d'Italo Balbo en Libye en 1934 et celle de Giuseppe Bottai après ses succès dans la constitution des corporations l'attestent.
Chef du gouvernement et des armées, président du Grand Conseil fasciste, à la tête de plusieurs ministères, Mussolini incarnait le pouvoir, le distribuait ou le reprenait [14] Face à Victor-Emmanuel III, le Duce fit bonne figure mais le tint surtout éloigné de l'exercice réel du pouvoir. De cette mise à l'écart, les récits des voyageurs français portent la trace [15] Paule Herfort expose la somme d'intérêts bien compris entre les pouvoirs italiens, où le roi laisse sagement agir Mussolini [16] L'intérêt des intellectuels français pour Balbo ou Bottai ne surgit qu'à l'occasion d'une étude sur les terres coloniales et les corporations : la question du successeur de l'homme providentiel se pose donc uniquement dans les termes dynastiques voulus par Mussolini lui-même, à savoir autour de la figure de son gendre, le comte Ciano [17]. Cependant les visiteurs ne purent percevoir exactement ce que la recherche historique récente a démontré, à savoir un jeu tactique et des conflits internes au sein même du Grand Conseil fasciste et du Parti [18] L'observateur étranger permet à la domination charismatique de s'exercer, au travers de son récit, puisqu'il fait écho à une « configuration où tous les centres alternatifs de pouvoir légitime ont été supprimés [19]
De la même manière, si les récits de voyage en Allemagne s'intéressent ponctuellement au maréchal Goering, à Joseph Goebbels ou encore à l'idéologue Alfred Rosenberg, tous n'ont véritablement d'yeux que pour le chancelier. Il apparaît souvent accompagné de hauts dignitaires du parti ou de l'État, mais il s'isole en tribune ou dans l'iconographie officielle. Les voyageurs ont parfois souligné ce travail de mise en scène à Nuremberg, effectué par la cinéaste Leni Riefenstahl. Impressionné par cette organisation, Philippe Barrès décrit la scène de septembre 1934 :
« Quand le Führer se met à parler, il paraît isolé pour toute l'arène mais nous, qui sommes au-dessus de lui, nous voyons l'activité fébrile des cinéastes cachés dans des trappes et qui le filment sous tous les angles, dirigés par Mlle Riffenthal [sic] [20]Un pouvoir dont l'isolement serait mis en scène ? Cette appréciation esthétique de Barrès mérite un détour par l'analyse des structures politiques nazies. Ian Kershaw a déjà souligné le morcellement du pouvoir hitlérien, puisque différentes administrations agissaient avec une autonomie certaine.
L'autorité du Führer fut davantage symbolique et rassembleuse que pratique et quotidienne. D'autant que les structures de l'État nazi ne pouvaient efficacement s'orienter au gré des obsessions idéologiques de Hitler, qui parfois « se dérobait aux décisions [21] ». Ce dernier établissait avec ses subordonnés des liens de fidélité, devenus principe de gouvernement dès 1933.
Ainsi le système nazi fut le cœur d'une concurrence des pouvoirs qui recoururent en dernière instance à la parole du Führer pour trancher les désaccords. Les récits de voyage à compter de juillet 1934 insistent tous pour rappeler que l'exécution des chefs de la S.A. puis le titre de Reichsführer pris par Hitler désignaient un gouvernement spécifique, faisant de Hitler un Caligula moderne. C'est à ce mode de gouvernement que l'écrivain Thierry Maulnier prête attention en juin 1935 dans la Revue universelle : faisant du nazisme un mouvement unificateur, complétant l'œuvre bismarckienne, Maulnier célèbre l'autonomie de la jeunesse allemande. Il donne au Führerprinzip, principe général de l'organisation sociale, des gages de pertinence. Ce principe unit le peuple et contraste avec la contestation véhémente du pouvoir en France. Il traverse ici toute la « communauté du peuple » pour rappeler que l'action de diriger s'exerce à toutes les échelles en fidélité au Führer.
Ceux qui partirent à sa rencontre ne dissimulèrent pas leur interrogation sur la nécessité d'un homme fort dont la mission sotériologique conviendrait à la France. En Allemagne, l'appel au Führer date de la remise en question du monarque en 1916. Dès que celui-ci s'avère défaillant, l'appel à la figure du commandement est motivé. Ce constat semble valoir pour nombre d'appels au chef, à une figure de l'autorité charismatique : le parlementarisme failli et l'incurie de gouvernements corrompus donnèrent du grain à moudre aux tenants de l'autorité forte en France [22]
Temps et lieux de la rencontre
La rencontre du dictateur ne se fait pas fortuitement, même s'il est partout. Elle procède d'une demande d'audience dans le cas de Mussolini, et la quasi-totalité du temps, participe d'une délégation officielle de journalistes internationaux ou de diplomates dans le cas du Führer, précisément lors des congrès du NSDAP. Souvent adressées à l'ambassade de France à Rome, qui transmettait au secrétariat de la présidence du Conseil, les requêtes pouvaient être plus rarement adressées à un proche du Duce, comme Paul Valéry le fit en 1924 auprès de Margherita Sarfatti et de Giuseppe Ungaretti [23] Le premier reporter français à accéder à Hitler en novembre 1933, Fernand de Brinon, confia avoir obtenu cette possibilité grâce à un « ami » allemand, membre du NSDAP, ancien combattant et pourfendeur du traité de Versailles, mais ami de la France : peut-être faisait-il allusion ici à Achim von Arnim, futur président de la Deutsche Französische Gesellschaft (Société franco-allemande).
Pour voir le Duce, les délais d'attente variaient d'une audience à l'autre. La masse de rencontres des intellectuels français avec le Duce nous permet de donner davantage de précisions. Ainsi la durée des rencontres pouvait varier de quelques dizaines de minutes, comme celle avec l'historien Georges Lacour-Gayet [24] le 5 avril 1934, jusqu'à deux heures pour Jean Fayard en février 1927. Plusieurs observateurs notent une diminution des entretiens accordés aux ressortissants étrangers à partir de 1937. Georges Roux témoigne de ce changement significatif dans l'accueil des intellectuels français par Mussolini, le contraignant pour l'occasion à rencontrer le comte Ciano. Il donne cependant une raison de santé à l'arrêt des audiences privées [25]
Tandis que pour les rares entretiens publiés du Führer avec des intellectuels français, la répartition est assez homogène, avec une densité au début de la période nazie : deux entretiens pour 1933 (Fernand de Brinon), 1934 (Lucien Lemas et Philippe Barrès), et 1936 (Titaÿna et Bertrand de Jouvenel), un seul pour 1937 (l'écrivain et journaliste littéraire Abel Bonnard) comme en 1938 (Alphonse de Châteaubriant). Encore s'agit-il des entretiens publiés, puisque Ferdinand Bac mena une conversation avec le Führer en 1935, consultable dans les papiers de l'écrivain à la bibliothèque de l'Arsenal. Parvenue à la Chancellerie, Suzanne Bertillon explique cette rareté de l'entretien avec Hitler :
« Voir Hitler, en tête à tête, il n'y faut pas songer. Le Führer est rebelle à l'interview ou du moins, n'y consent qu'à des conditions qui sont au-dessus des moyens du journaliste qui voyage à petites journées [26]Ceux qui parvinrent jusqu'à lui, tels Brinon et Jouvenel, passèrent cependant près de deux heures d'entretien en sa compagnie. La longueur relative de l'interview pouvait s'expliquer par la tâche de l'interprète associé à l'échange. Il faut également rappeler les nombreuses demandes éconduites par Hitler : ainsi parmi les plus notables, celle de l'écrivain académicien Pierre Benoît qui, malgré l'entremise de l'ambassadeur André François-Poncet, ne put rencontrer le chancelier en août 1935, tandis qu'il avait obtenu audience auprès de Mussolini à son retour d'Abyssinie, le 16 juillet 1935 [27] Par cette inégalité entre les rencontres du Duce et celles du Führer, on pourrait conclure à une défiance des représentants nazis vis-à-vis des intellectuels français, à leur souci de maintenir une distance, un mystère, de maîtriser une propagande, ou encore à l'obsession de l'attentat. Il faudrait pour cela se pencher sur les papiers de Wilhelm Brückner ou de Fritz Wiedemann, patron et membre de l'Adjudantur, responsable des affaires personnelles et de l'agenda du Führer.
Partis à la rencontre du dictateur italien, ces écrivains-reporters vont accéder au statut d'habitués, et revoir le Duce à plusieurs reprises, comme les écrivains Édouard Schneider (cinq fois) ou Henri Béraud (quatre fois). Les rencontres se sont déroulées dans divers endroits : au palais Chigi, introduits sur lettre de recommandation par des huissiers vers une pièce donnant sur le Corso, les voyageurs français furent invités à compter de septembre 1929 au palais de Venise, dans la salle de la Mappemonde, beaucoup plus rarement à la villa Torlonia, villégiature familiale mussolinienne. Les récits insistent souvent sur l'austérité du bureau du Duce, dénotant une manière de gouverner :
« Pas un papier, pas un dossier. Cet homme n'écrit pas ; il parle ; il commande [28]»Hitler, pour sa part, pouvait recevoir des délégations dans sa résidence bavaroise de Berchtesgaden, où il reçut Alphonse de Châteaubriant le 2 septembre 1938, dans la forteresse de Nuremberg [29] ou au quatrième étage de ses appartements privés de la Chancellerie à Berlin. De Brinon y décrit l'instant précédant son audience et le décor de l'événement :
« Un immense vestibule aux dalles blanches polies, une longue table couverte de brochures et de papiers, de jeunes S.S. en uniforme noir, qui font au visiteur le salut romain. Des allées et venues rapides, trois petits groupes [...]. Surtout un air de jeunesse et de simplicité. [...] Je regarde et j'écoute. Quelle différence avec le cérémonial ordinaire des palais gouvernementaux. Pas de visiteurs attendant leur tour d'audience, pas d'huissiers, aucun protocole. [...] Le voici, il avance, fait à mon intention le salut rituel, tend la main, puis désigne son bureau. Grande pièce carrée [...] une table de chêne nette, avec des bougeoirs figurant des croix gammées au-dessus de la cheminée, un portrait de Frédéric II [30]»Lors de son entretien en 1934, Philippe Barrès s'attarde sur le cadre médiéval de la forteresse de Nuremberg. Outre le fait qu'il ne le rencontre pas en « tête à tête », la même simplicité se détache de la scène à laquelle il assiste. Le Führer n'est pas seul mais flanqué des autres hommes forts du régime :
« Dans la demi-lumière de cette demeure du Moyen Âge, [...] le voici déjeunant d'un sandwich, avec [Rudolf] Hess et [Victor] Schleiter. [...] Le soleil allonge vers eux, par les fenêtres gothiques, des rayons qui rehaussent les ombres. Dehors, dans les rues profondes, parmi les vieux toits et les pignons baroques de Nuremberg, la foule crie toujours [31]En 1938, Alphonse de Châteaubriant est conduit en Mercedes depuis Berchtesgaden vers le Berghof. Parvenu au chalet, il décrit une vaste maison composée de murs blancs : l'écrivain lui accorde une importance majeure puisque les plans ont été dessinés par Hitler lui-même :
« Quand on voit cette maison [...], si simple et qui paraît aussi fragile que celui d'une bergerie, on touche au ressort de nécessité qui conduisit ici un jour celui qui, déjà dans sa prison de Landsberg, avait écrit ces mots : "Le fort qui est seul est encore plus fort [32] »Puis il s'essaie au portrait avec précaution :
« Il est vêtu d'un costume gris d'été, les épaules fortes, la tête ronde, la figure pleine... la figure que l'on sait, la coiffure que l'on sait, la taille que l'on sait. [...] C'est au contraire le côté saisissant du visage d'Hitler d'être un peu le visage de beaucoup d'autres [33]»Surgit ainsi une des modestes raisons qui motivent la rencontre du dictateur : en faire le portrait. Est-ce l'unique objectif de ces voyageurs ?
À la recherche de l'autorité politique
Une rencontre pour quoi faire, pour dire quoi ? Faire le portrait de l'homme d'État et de ses qualités, l'approcher et le saisir dans l'intimité, confirmer ou infirmer ce que la propagande diffuse, échanger sur les relations internationales, comprendre le régime nouveau, partager des références culturelles communes... autant de motivations à ces rencontres qu'il nous faut préciser. Notre propos n'est pas d'examiner toutes les conditions de production de la figure du Duce ou du Führer, mais de souligner que ces intellectuels français ont subi l'attrait des figures charismatiques de l'autorité politique plus qu'ils n'en ont décrypté les rouages.
Les deux dictateurs n'ont pas suscité les mêmes enthousiasmes dans les récits de voyage. Si Mussolini incarnait le rempart contre le communisme, il était d'abord italien et cette communauté latine suscitait un ralliement assez large des intellectuels français autour de l'action du Duce, et ce malgré la guerre d'Éthiopie. Or Hitler, prétendant lui aussi faire barrière au bolchevisme, ne pouvait que concentrer les angoisses d'intellectuels français aux prises avec les souvenirs proches de la Grande Guerre, autour de la réactivation du spectre d'un prussianisme conquérant. Les projets d'entente franco-allemande n'avaient pas attiré les foules à compter de 1933, en dépit des déclarations de paix faites par le gouvernement nazi. La constitution en novembre 1935 du Comité France-Allemagne forma une élite ouverte aux menées de Hitler, même si l'ambiguïté planait encore sur les intentions réelles du Führer. Cherchant à rencontrer ou à décrire le dictateur, les voyageurs français ont perpétué une vision dithyrambique de Mussolini, plus nuancée concernant Hitler, dans des versions différentes de la rencontre avec l'« homme nouveau ».
Saisir les traits du premier des hiérarques constitue ainsi une figure récurrente dans ces récits de voyage. Portraitistes ou sculpteurs sur papier, les écrivains et reporters ont croqué le visage des dictateurs avec plus ou moins d'enthousiasme. Ainsi, Jean Fayard, reçu en audience en 1927, pénètre au palais Chigi et aperçoit une femme sculpteur occupée à réaliser le buste du chef du gouvernement. La scène le stimule, il se lance alors dans le détail du visage du tyran [34] Virilité, énergie du regard (une constante des récits d'entretiens), mâchoire puissante, le Duce dispose d'atouts « fascinants », et le reporter semble succomber. Certains récits ont pourtant marqué un contraste entre l'image publique du Duce et celle affichée en audience privée [35] : celui-ci saurait se montrer souriant, détendu, « tout autre que ses portraits le montrent [36] ». Tous les intellectuels ne contribuent donc pas au mythe traditionnel de l'homme fort, et Bedel notamment ironisa pour amoindrir le prestige des « Messieurs » devenus guides du peuple. Le rayonnement à l'étranger du chef d'État dépend donc de l'accointance politique du portraitiste avec son objet. Dans un article de 1936, illustré de clichés montrant le Duce dans ses actions d'homme d'État et de travailleur, on note l'application de Pierre Scize à pointer les incapacités du guide fasciste et les manifestations de défiance populaire à l'égard de ce dernier. Présentant une Italie terrorisée [37] Scize donne la parole aux opposants. Le contraste entre le texte et l'image saisit le lecteur, confronté à une iconographie officielle en même temps qu'à la confidence critique du peuple. Le reporter souligne aussi les tensions avec le roi, et ce afin de nuancer la presse trop largement acquise à l'image réconciliatrice du leader fasciste. Montrer l'image, la déconstruire et démasquer l'imposture fasciste sont ici les perspectives de ce reporter.
Majoritairement, les visiteurs du Duce louèrent ses qualités intellectuelles et son sens politique, comme lorsqu'Émile Schreiber et Henri Béraud virent respectivement en lui l'équivalent italien du colonisateur Lyautey [38]et de Clemenceau [39] Figure césariste par ses attributions et ses pratiques, Mussolini fut surtout comparé à Napoléon dans les récits de notre corpus. Parmi les laudateurs du régime, Paule Herfort précise : « Et [...] je dis Mussolini comme on dit Napoléon ou César. De tels noms se suffisent à eux-mêmes [40]» Pour des raisons plastiques [41], son goût de l'exposition publique [42], ses aptitudes analytiques [43], sa relation autoritaire au peuple [44] le Duce rassemblait aux yeux des intellectuels français toutes les caractéristiques de la réincarnation moderne de l'empereur français.
Perce ici une ambition pédagogique. Si l'Italie avait trouvé un chef digne de la mener à des réalisations économiques et sociales objectives, les voyageurs français ambitionnaient de détecter les qualités de cet homme d'État, dont les politiques français devaient s'imprégner. Ces qualités devaient d'abord être recherchées dans l'histoire personnelle du chef, dimension inséparable de la constitution du mythe charismatique. Dans nombre de portraits ou d'incipit d'entretiens, Mussolini est présenté comme un homme du peuple ayant souffert et connu la misère dans ses premières années d'existence. Cependant, ses périples suisses de travailleur manuel et ses qualités au front furent largement gonflés par les hagiographies d'époque, tout comme l'origine prolétarienne de sa famille [45]. Pourtant ce que les voyageurs français retiennent durant l'entre-deux-guerres participe largement du mythe de l'homme d'État parfait, constamment au travail. Toutes les qualités du politique sont réunies dans sa personne : selon Paule Herfort, le bon sens, l'intuition et la psychologie [46) Louis Gillet, rencontrant le Duce en audience le 8 novembre 1932, s'étonna de la fraîcheur de son interlocuteur au terme d'un périple entre Turin, Brescia, Forli et Viterbe [47]Cependant, l'historien Pierre Milza a très justement affiné cette image travaillée par Mussolini [48] et reprise sans recul par les voyageurs. Davantage qu'un surhomme doté naturellement de multiples talents intellectuels et physiques, Mussolini s'est attaché à se montrer à la fois exceptionnel et proche de son peuple. S'il excelle par ses compétences, c'est davantage par sa volonté, son action et son souci de la performance que par des dons inouïs. Rattaché à la tradition d'une Italie profonde par son corps robuste de Romagnol, Mussolini tend également vers l'homme nouveau par ses talents de leader politique et d'autodidacte.
40Dévisager le tyran, démêler les fils de son histoire, comprendre ses qualités d'homme ou de surhomme participe également des motivations de la rencontre avec le Führer. Les récits biographiques de Hitler peignent le portrait d'un homme ayant également connu la misère, en Autriche, les affres de la guerre mondiale, la prison et un combat politique de longue haleine avant de conquérir le pouvoir. Dès l'entre-deux-guerres, des biographies sont proposées au public français : après un long portrait du chancelier en octobre 1933 [49] André Beucler publia en 1937 L'Ascension d'Hitler [50] Armand Pierhal, germaniste, traduisit les recherches de Konrad Heiden autour de l'histoire de Hitler. Mais les récits de voyage s'attachent à bien d'autres aspects que l'histoire du Guide. Si le regard de Mussolini fut vanté pour sa force et sa beauté, les récits des observateurs français font figurer, comme atout indéniable du Führer, sa voix, son talent de manieur de foules. Déjà Philippe Barrès indiquait lors de sa rencontre à Nuremberg en 1934 la capacité enveloppante de sa voix en public, « belle et chantante [51]», tout comme elle incitait au silence dans la conversation privée. Pierre Frédérix en fait un démagogue hors pair. Ses aptitudes rhétoriques et charismatiques sont célébrées, non sans quelque fascination chez le voyageur français :
« À Berlin l'autre jour, je l'ai entendu parler devant quinze mille personnes, sans une note, pendant une heure quarante [...]. Et comme il s'adapte à l'auditoire ! Au Reichstag, homme d'État ; devant les agriculteurs, homme de la glèbe ; à Siemens Stadt, pur démagogue [52]»Mais le Führer semble insaisissable dans sa personnalité même. Le contraste entre plusieurs masques d'acteur portés par Hitler revient souvent dans les récits : l'écoute de ces discours, où il déclare briser la terreur par la terreur, s'associe mal à ces photographies le montrant caresser chiens et embrasser petites filles. « Hitler intime » est donc un genre peu couru par les intellectuels français, faute de contacts rapprochés et de cohérence ressentie. Genre dangereux, comme le prouve la quasi-saisie du numéro du Journal daté du 22 février 1936 et de sa partie magazine, consacrée à la vie amoureuse du chancelier, sur demande des autorités allemandes [53] Alors, quelle image donner ? Pierre Frédérix brosse le portrait d'un homme simple, modéré, maître de lui-même, à l'opposé de ses emportements publics [54]L'image d'un homme sans excès, végétarien, sans addiction, est légèrement contredite par Suzanne Bertillon, lorsqu'elle enquête à Munich :
« Des gens bien informés m'ont affirmé que sa fortune lui a déjà permis d'acheter plusieurs immeubles et d'entretenir plusieurs autos. C'est un homme prétentieux, au caractère épouvantable, m'ont-ils dit, qui professe des goûts simples, dont seuls les naïfs sont dupes [55] »Cependant, cette « révélation » de 1933 comportait une large part de vérité. Des travaux récents [rappellent le caractère construit de l'image publique du dictateur, tandis que l'homme exerçait son goût du luxe par l'achat de Mercedes neuves, constituait une fortune massive à l'abri de la fiscalité, grâce aux ventes de Mein Kampf gérées par l'éditeur Max Amann, grâce au « don de l'économie allemande à Adolf Hitler » (0,5 % des coûts salariaux annuels pour chaque employeur), grâce aux ventes de timbres à son effigie à partir de 1937.
Maurice Bedel, s'approchant de Hitler au congrès de Nuremberg de septembre 1937, rapporte un récit aux accents moqueurs, qui tranchent avec le reste du corpus. L'éloquence du Führer lui semble lassante. Quant à son charme tant vanté, il ne manque pas d'en souligner la banalité :
« Son nez est épais, sans dessin, les narines sont lourdes. [...] J'ajoute que son corps manque de noblesse. Sans être tombantes, les épaules n'ont point la carrure qu'on s'attend à voir d'un homme qui porte tant de responsabilités [57] »Ainsi le physique du Führer ne convainc pas notre écrivain, qui lui préfère sa voix, une fois de plus, dont il reconnaît la savante manipulation des sens de son auditoire. Mais il ne se montre pas dupe des formes de séduction employées, à l'occasion d'un déjeuner où les amabilités verbales associées aux rasades de vins ne lui firent pas oublier la déclaration d'hostilité totale à la France mentionnée dans Mein Kampf [58]Poursuivant d'autres buts, Fernand de Brinon et Bertrand de Jouvenel constataient la simplicité de la mise et de l'attitude de Hitler confortaient à dessein le mythe du surhomme resté humble soldat : que le Führer fût un héros pour l'Allemagne, qu'il apparût comme un homme simple mais pétri de talents, que sa trajectoire fût celle du sauveur sacrifié, les intellectuels français brossant son portrait n'ont pas cherché à le démentir. Seuls les textes de Suzanne Bertillon et de Maurice Bedel osent donc écorner le mythe du Siegfried contemporain.
48Au fil de cette quête de l'homme d'État, le récit révèle une ambition pédagogique qui éclaire une partie du projet des voyageurs. Chacun des auteurs de récit, dont il serait trop long de retracer l'itinéraire dans son champ spécifique, ambitionne une position d'autorité intellectuelle voire politique [59]Médiatiques, ces intellectuels voyageurs se sont rêvés prédicateurs modernes, médecins du corps politique français, habiles à diagnostiquer les travers culturels et à prescrire un remède national. Cette attraction française pour l'élaboration d'une figure de l'autorité mérite une forme d'explication.
49Plusieurs études ont formulé une étiologie pour ce qui, chez les intellectuels français, pouvait être désigné sous le terme de « tentation autoritaire » : il semble que l'antiparlementarisme, les expériences ligueuses et les réflexions menées au sein des partis traditionnels de droite l'attestent [60] Une partie des libéraux, de Tardieu à Barthélémy, réclament dès 1934 un renforcement de l'exécutif et contestent même la légitimité démocratique. La crise du lien social, la menace d'une révolution de type bolchevique et la crainte d'une dissolution nationale fondent ces appels à l'autorité, voire à l'autoritarisme. Nombre d'hebdomadaires, de Plans tenu par Philippe Lamour à Pamphlet d'Alfred Fabre-Luce et Jean Prévost, ont appelé de leurs vœux une révolution nouvelle pour la France, imitant l'Allemagne ou l'Italie, comme l'émergence forcée ou spontanée d'un guide. Lors d'une conférence du 25 novembre 1935, le groupe Contre-Attaque, fondé par Georges Bataille et André Breton, souhaite une révolution faisant preuve d'une « autorité intraitable » face aux abîmes de la démocratie d'alors, considérée comme une absence d'autorité. L'écœurement face à l'impuissance parlementaire forme un socle commun des prétentions à l'action chez nombre d'intellectuels français de l'entre-deux-guerres. Ces derniers n'appellent pas toujours à la même solution : le peuple pour la gauche, un maître pour la droite. Cette recherche de l'homme fort à droite peut être comprise grâce à la formule de Claude Roy. Issu du courant maurrassien, l'écrivain justifie son attrait, et celui d'une génération, pour la question du commandement par la nécessité de combler un vide :
« Bien sûr, j'ai trouvé aussi la politique parce que j'avais perdu Dieu. Le besoin d'une religion, d'une foi, d'une Église. [...] J'ai mis des années à démêler l'étouffant réseau de substitutions dans lequel je m'empêtrais : persécuteur (aristocrate) et persécuté (masochiste) demandant au monarque ou au Parti, au chef ou au dirigeant, d'être ce Père que ni mon père, ni Dieu, n'avaient consenti à être [61]»51Une large part de ces intellectuels voyageurs appartient à la génération décrite par Roy.
Que dire au dictateur ? De la propagande et de l'autopromotion
De quoi parlent ces intellectuels avec les dictateurs ? Vécu comme le paroxysme d'un voyage en Italie, l'indispensable étape d'une enquête bien menée, l'entretien avec le Duce est une occasion pour l'intellectuel de lui confier souvent son admiration, et de constituer ainsi par le récit une part du mythe autour de l'homme responsable de la « régénération de l'Italie ». Les contenus des entretiens pouvaient varier. En 1927, Mussolini accueille Jean Fayard en réclamant une conversation amicale où l'on évoque la politique européenne. Louis Madelin en 1934 traite de politique, d'histoire, de l'écrivain Chateaubriand, et souhaite surtout connaître l'homme restaurateur de l'Italie, qu'il assimile à un constructeur [62]. Certains profitent de l'occasion pour faire don d'un présent au Duce. Le 5 avril 1935, l'historien Lacour-Gayet offrit ainsi au Duce deux ouvrages dont il était l'auteur. Les archives italiennes [64]. nous rappellent enfin qu'en décembre 1932, Ferdinand Bac, lié par sa famille à Jérôme Bonaparte, envoie au secrétariat particulier du Duce l'« Appel aux Romains », à joindre aux lettres de Cavour qu'il lui avait apportées en octobre 1932 pour les dix ans du régime. Bac souhaitait faire don de ces vingt-deux lettres de Cavour à la nation italienne. De façon globale, les modifications urbaines de la capitale et les grands travaux d'aménagement nationaux, la vie politique française, la vie littéraire et culturelle, les relations internationales sont au cœur de toutes les conversations. Henri Massis et le Duce évoquèrent des références communes à leur jeunesse, autour de Charles Péguy et de Georges Sorel [65] lui, Émile Schreiber partageait avec le Duce le principe d'utilisation nécessaire de la violence en gouvernement [66] En novembre 1932, Daniel Halévy se félicita de constater que Mussolini avait lu sa biographie de Nietzsche publiée en 1909 [67] Le ton de la conversation était généralement détendu, ouvert aux sujets les plus variés. Malgré la censure pesant sur les articles d'Henri Béraud pour Le Petit Parisien du printemps 1929 (poussant l'auteur de Ce que j'ai vu à Rome à affirmer son antifascisme, en dépit de son goût marqué pour l'autorité au fil de l'ouvrage), l'écrivain rappela :
53
« Cela ne nous autorise-t-il pas à penser que le Cabinet du Duce est, dans toute l'Italie, l'endroit unique où l'on peut en toute franchise s'exprimer librement sur les incommodités de la dictature [68][68]H. Béraud, Ce que j'ai vu..., op. cit., p. 236-237.. »54On note la volonté du voyageur d'afficher une proximité, voire de peindre un échange mené sur un pied d'égalité avec l'homme fort du régime.
Bertrand de Jouvenel, qui interviewa les deux dictateurs au cours de la même année 1936, témoigne des sujets internationaux comme d'un sujet central de la rencontre. Le 21 février 1936, il s'entretint avec le chancelier dans ses appartements privés à Berlin, confia avoir eu un échange détendu avec le Führer, marquant ses intentions pacifiques. Il avait été introduit par Otto Abetz, vieille connaissance des réseaux d'entente des jeunesses franco-allemandes. En dépit de la volonté du parlement français de signer un pacte avec les Soviétiques, Hitler réaffirme, aux dires de Jouvenel, son objectif de bonne entente avec la France. Bien que l'article final fût rejeté par les services allemands de Ribbentrop, modifiant la réaction hitlérienne au cas où ce pacte était ratifié, le sujet de l'entretien concernait au plus haut degré les relations franco-allemandes. De la même manière, le 1er juin 1936, par la force de son ascendance (son père Henry fut ambassadeur à Rome entre 1932 et 1933), Jouvenel n'eût pas de difficulté à obtenir une audience du Duce. Il oppose alors la rude franchise de cette conversation aux circonvolutions de l'échange avec Hitler trois mois plus tôt. L'objet de sa visite consistait à sonder les intentions du Duce au sujet d'une Autriche menacée par l'Allemagne et souhaitant une protection française. Allait-il jouer la carte de l'alliance avec la France pour protéger les intérêts de l'Europe centrale ? Mussolini lui répondit favorablement, y compris sur la protection de la Tchécoslovaquie, à la condition que le gouvernement Blum reconnût l'Empire italien en Éthiopie.
De même Fernand de Brinon avait cherché à sonder les intentions hitlériennes envers la France, en particulier après la diffusion des écrits de Mein Kampf. Systématiquement, le même argumentaire vient atténuer la violence de la charge antifrançaise, justifiant le propos hitlérien par le contexte d'écriture, celui d'un homme persécuté, emprisonné, souffrant d'une Ruhr alors occupée par l'armée de l'Hexagone. Alphonse de Châteaubriant conduisit l'entretien de 1938 en direction de la menace bolchevique en Europe, rattachée directement à l'expérience de Hitler dans la Vienne d'avant-guerre. Mais il traita aussi de la liberté individuelle et de l'économie autarcique dans le Troisième Reich, sans négliger les traditionnelles intentions de paix du régime envers la France. Les autres entretiens, en particulier celui de Maurice Barrès en septembre 1934, consistèrent à expliquer les causes de son succès, la force de persuasion qu'il avait employée pour convertir ces foules défilant fidèlement au pas de l'oie dans Nuremberg, et partout ailleurs en Allemagne. Ainsi allaient les rencontres avec le Führer, faites d'inquiétude pour la relation franco-allemande, de souci d'une Europe pacifiée, de précisions sur les réalisations concrètes du régime obtenues au prix de sacrifices dont il s'agissait de définir les contours. Rappelons brièvement ici que les voyageurs ayant obtenu audience auprès de Hitler n'ont cessé de le soutenir, par des biais plus ou moins directs, de l'entre-deux-guerres jusqu'à 1945. Les récits des rencontres réalisées avant 1939 ont donc considérablement affaibli les possibilités de l'opinion de mesurer la signification des ambitions nazies.
Voir la figure, comprendre les raisons du succès politique, les déraisons d'une mystique nationale, mesurer les intentions d'un régime à l'égard de la France en s'adressant à sa tête « pensante », confier son admiration et parler en ami, faire valoir sa compétence de reporter et son entregent par l'exclusivité, devenir à son tour auteur, figure d'autorité pour avoir rencontré l'autorité en personne : telles sont les ambitions des intellectuels français partis à la rencontre des dictateurs fasciste et nazi. Il semble difficile d'échapper à l'image du tyran en Allemagne comme en Italie ; ainsi tout observateur avisé mentionne, même fortuitement, un rapide portrait de l'action ou de la personnalité du leader local. Les portraits dressés dans les récits sont variables, nous l'avons vu, surtout dans la quantité, à l'avantage de celui du Duce. Les méfiances historiques de la France à l'égard de l'Allemagne rendent le contact moins facile, moins régulier, et l'admiration moins spontanée pour la personnalité du Führer, à l'exception de ses talents d'orateur. Ce que Daniel Halévy transcrivait dans la citation placée en introduction, c'était la légitime appréhension des élites de droite nationaliste, traditionaliste, mais possiblement unies autour d'une Europe latine : il brossait le portrait d'un groupe d'intellectuels proches d'Henri Massis, combattant le romantisme germanique. À leurs yeux, Hitler était beaucoup moins un contre-révolutionnaire que le démon de la révolution social-germanique depuis cent ans grossissante au centre de l'Europe. S'ils détestaient l'encadrement de la jeunesse et l'étatisme radical du fascisme, la rencontre avec Mussolini dépassait souvent leurs attentes et faisait oublier les errements du régime ; ce que les récits de la rencontre avec Hitler ne pouvaient affirmer dans la presse française de l'entre-deux-guerres.
Toutefois, la concentration des récits autour des figures de Hitler et de Mussolini contribue à façonner à l'étranger une image maîtrisée par les propagandes fasciste et nazie, achevant la personnification de l'État totalitaire. Relayant sans critique les déclarations de foi fasciste et les manifestations de ferveur collective autour du Führer et du Duce, les récits des intellectuels français ont vectorisé ces dominations charismatiques. D'autres récits, moins nombreux, ont porté leur attention aux résistances variées, aux antifascistes qui, dans l'Europe brune et noire, cherchaient à faire vivre une autre Allemagne, une autre Italie. Ces récits sont les portraits en creux des limites de la domination charismatique : ils n'ont ni les mêmes auteurs, ni les mêmes supports médiatiques que ceux de la rencontre avec le dictateur [69]
Notes
- [1]Daniel Halévy, « Sur Les Chefs : après Défense de l'Occident », Candide, 28 juin 1939.
- [2]Pascal Ory et Jean-François Sirinelli, Les Intellectuels en France : de l'affaire Dreyfus à nos jours, Paris, Perrin, 1987, 2004, p. 13.
- [3]Durant l'entre-deux-guerres, l'essor de la presse à grand tirage et la mode de l'envoyé spécial favorisent la mixité des genres : les grands reporters sont des transfuges de la littérature en mal d'action, des doubles-plumes, comme Henri Béraud, Roland Dorgelès ou Joseph Kessel. Cette interpénétration des milieux de l'écriture-fiction et journalistiques se trouve portée par des collections éditoriales de reportage qui conquiert un statut littéraire plus durable.
- [4]Claude Lefort, L'Invention démocratique : les limites de la domination totalitaire, Paris, Fayard, 1981, p. 92.
- [5]Voir Yves Cohen, Le Siècle des chefs : une histoire transnationale du commandement et de l'autorité (1890-1940), Paris, Éd. Amsterdam, 2013, p. 249 et 257.
- [6]Ibid., p. 255.
- [7]Ibid., p. 280.
- [8]Georges Imann, « Hitler partout », Candide, 2 avril 1936.
- [9]Maurice Bedel, Monsieur Hitler, Paris, Gallimard, 1937, p. 20.
- [10]Henri Jeanson, « Au pays des chemises noires : dans Rome endormie », Paris-Soir, 4 novembre 1923.
- [11]Maurice Bedel, Fascisme an VII, Paris, Gallimard, 1929, p. 9.
- [12]Henri Béraud, Ce que j'ai vu à Rome, Paris, Les Éditions de France, 1929, p. 37.
- [13]Voir Jean-Yves Dormagen, « Le Duce et l'État-major du fascisme : contribution à une sociologie de la domination charismatique », Revue d'histoire moderne et contemporaine, 55 (3), 2008, p. 35-60.
- [14]Didier Musiedlak, Mussolini, Paris, Presses de Sciences Po, 2005, p. 315-323.
- [15]Édouard Helsey, « Le Journal en Italie », Le Journal, 24 mars 1927 ; Georges Roux, L'Italie fasciste, Paris, Stock, 1932, p. 63.
- [16]Paule Herfort, Chez les Romains fascistes, Paris, Éditions de la Revue mondiale, 1934, p. 34.
- [17]Voir Berthe Vulliemin, « Une visite au comte Ciano », Revue des deux mondes, 1er janvier 1938 ; les récits de G. Roux, L'Italie fasciste, op. cit. ; de Blandine Ollivier, Jeunesse fasciste, Paris, Gallimard, 1934.
- [18]D. Musiedlak, Mussolini, op. cit., p. 340-407 ; id., « Mussolini : le grand dessein à l'épreuve de la réalité », Parlement(s) : revue d'histoire politique, 13, 2010, p. 52-62 ; Salvatore Lupo, Le Fascisme italien : la politique dans un régime totalitaire, Paris, Flammarion, 2003.
- [19]J.-Y. Dormagen, « Le Duce... », op. cit., p. 46.
- [20]Philippe Barrès, « En tête à tête avec Hitler », Le Matin, 10 septembre 1934.
- [21]Ian Kershaw, The Nazi Dictatorship : Problems and Perspectives of Interpretation, Londres, E. Arnold, 1989 ; trad. fr., id., Qu'est-ce que le nazisme ? Problèmes et perspectives d'interprétation, trad. de l'angl. par Jacqueline Carnaud, Paris, Gallimard, 1992, 1997, p. 143.
- [22]Quitte à réagir à la « décadence démocratique » comme au fascisme par un ambigu « sur-fascisme » selon les termes de Jean Dautry. Voir Georges Bataille et André Breton, « Contre-Attaque », Union de lutte des intellectuels révolutionnaires : les Cahiers et les autres documents, octobre 1935-mai 1936, Paris, Ypsilon éditeur, 2013, p. 32.
- [23]Michel Jarrety, Paul Valéry, Paris, Fayard, 2008, p. 566-568.
- [24]D'après sa lettre du 11 avril 1934 à l'ambassadeur de France à Rome, Centre des Archives diplomatiques de Nantes (CADN), carton 927.
- [25]Pierre Milza rappelle les soins reçus par le Duce pour un ulcère à l'estomac, probablement plus fantasmé que réel, au terme de l'autopsie réalisée sur le corps de Mussolini. L'état de santé de ce dernier faisait également partie de la propagande fasciste, jouant sur une distance et une proximité du chef avec son peuple.
- [26]Suzanne Bertillon, « Une Française à la maison brune », Le Matin, 24 janvier 1933.
- [27]D'après les archives d'Albin Michel, citées dans Gérard de Cortanze, Pierre Benoît : le romancier paradoxal, Paris, Albin Michel, 2012, p. 293.
- [28]M. Bedel, Fascisme an VII, op. cit., p. 11.
- [29]P. Barrès, « En tête à tête... », op. cit., p. 1.
- [30]Fernand de Brinon, « Une conversation avec Adolf Hitler », Le Matin, 22 novembre 1933, p. 1.
- [31]P. Barrès, « En tête à tête... », op. cit., p. 1.
- [32]A. de Châteaubriant, « Hitler m'a dit », op. cit., p. 1.
- [33]Ibid.
- [34]Jean Fayard, « Deux mois à Rome : un entretien avec Mussolini », Candide, 24 février 1927. Les audiences des voyageurs français avec Mussolini de 1930 à 1940 ont été listées et en partie analysées par Christophe Poupault dans l'annexe 2 de sa thèse de doctorat « À l'ombre des faisceaux : les voyageurs français dans l'Italie des chemises noires (1922-1943) », Université Paris-X, sous la direction de Didier Musiedlak, 2011, p. 783-794.
- [35]Pierre Mac Orlan, « L'Italie nouvelle : devant Il Duce », L'Intransigeant, 10 février 1925 ; Claude Blanchard, « Le Petit Journal en Italie : une interview de Mussolini », Le Petit Journal, 24 février 1928 ; René Benjamin, Mussolini et son peuple, Paris, Plon, 1936, p. 236 ; Ferdinand Bac, Promenades dans l'Italie nouvelle, Rome, Paris, Hachette, 1933, p. 161.
- [36]M. Bedel, Fascisme an VII, op. cit., p. 10.
- [37]Pierre Scize, « L'Italie ? J'en viens... », Voilà, 9 mai 1936, p. 5.
- [38]Émile Schreiber, Rome après Moscou, Paris, Plon, 1932, p. 117.
- [39]Henri Béraud, « Une interview de M. Mussolini », Le Petit Parisien, 11 novembre 1922.
- [40]P. Herfort, Chez les Romains fascistes, op. cit., p. 16.
- [41]Ludovic Naudeau, L'Italie fasciste ou l'autre danger, Paris, Flammarion, 1927, p. 69.
- [42]François Mauriac, « Impressions de Rome », Le Journal, 3 janvier 1935.
- [43]J. Fayard, « Deux mois à Rome », op. cit. ; Henri Bordeaux, La Claire Italie, Paris, Plon, 1929, p. 107.
- [44]Louis Madelin, « L'Italie nouvelle », Revue hebdomadaire, 24 février 1934, p. 407.
- [45]Voir sur ces points, D. Musiedlak, Mussolini, op. cit., p. 120-126.
- [46]P. Herfort, Chez les Romains fascistes, op. cit., p. 236.
- [47]Louis Gillet, Rome et Naples, Paris, Éditions des portiques, 1933, p. 76-77.
- [48]Pierre Milza, « Mussolini, figure emblématique de l'"homme nouveau" », in Marie-Anne Matard-Bonucci et Pierre Milza (dir.), L'Homme nouveau dans l'Europe fasciste (1922-1945) : entre dictature et totalitarisme, Paris, Fayard, 2004, p. 75-86.
- [49]André Beucler, « Une journée d'Hitler », Le Petit Parisien, 5 octobre 1933, p. 1.
- [50]André Beucler, L'Ascension d'Hitler : du village autrichien au coup d'État de Munich, Paris, Les Éditions nationales, 1937.
- [51]P. Barrès, « En tête à tête... », op. cit.
- [52]Pierre Frédérix, « Hitler manieur de foules », Revue des deux mondes, 1er mars 1934, p. 68.
- [53]Sur cette interdiction de vente dans les kiosques à la demande de l'ambassade d'Allemagne en France, voir « À la requête de la Wilhelmstrasse », Le Journal, 23 février 1936, p. 1.
- [54]Ibid., p. 70.
- [55]Suzanne Bertillon, « Une Française à la maison brune », Le Matin, 24 janvier 1933.
- [56]Volker Ullrich, Adolf Hitler : Biographie, vol. 1 : Die Jahre des Aufstiegs, 1889-1939, Munich, S. Fischer, 2013.
- [57]M. Bedel, Monsieur Hitler, op. cit., p. 57-58.
- [58]« Aucun renoncement ne doit nous paraître impossible si nous avons finalement la possibilité d'abattre l'ennemi qui nous hait si rageusement : la France. » (Adolf Hitler, Mein Kampf, cité par M. Bedel, Monsieur Hitler, op. cit., p. 61.
- [59]Pour un développement de ce point, voir Alexandre Saintin, « Tristes tropismes : voyages des intellectuels français en Italie fasciste et en Allemagne nazie (1922-1939) », thèse de doctorat en histoire, Université Paris-I, sous la direction de Pascal Ory, 2015, chap. 7.
- [60]Voir Mathias Bernard, « L'antiparlementarisme de droite dans la France des années 1930 », Parlement[s] : revue d'histoire politique, 3, 2013, p. 99-111.
- [61]Claude Roy, Moi je, Paris, Gallimard, « Folio », 1993, p. 208.
- [62]L. Madelin, « L'Italie nouvelle », op. cit., p. 406-407.
- [63]CADN, archives rapatriées de l'ambassade de France à Rome-Quirinal, carton 927, lettre du 11 avril 1934 à l'ambassadeur de France à Rome.
- [64]Archivio centrale dello Stato (ACS) Rome, Fascicolo 136742 Ferdinand Bac.
- [65]Henri Massis, « Mussolini comme je l'ai vu », Revue universelle, 15 juin 1937, p. 646.
- [66]Émile Schreiber, « Entretien avec Mussolini », L'Illustration, 17 septembre 1932, p. 83.
- [67]Daniel Halévy, Courrier d'Europe, Paris, Grasset, 1933, p. 287.
- [68]H. Béraud, Ce que j'ai vu..., op. cit., p. 236-237.
- [69]Voir A. Saintin, « Tristes tropismes... », op. cit., chap. 8.


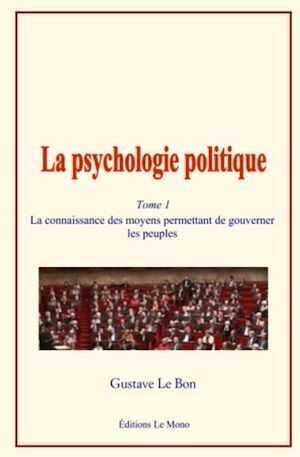
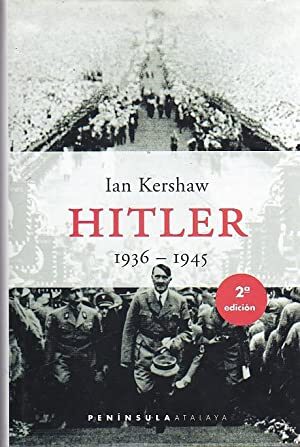



Alors que dire de ceux qui les adulent, perpétue leur folie à l'heure actuelle, et ce qu'il se passe en Ukraine, dans les sphères de l'otan, l'onu, des gouverne-ments etcccc.
Cela en dit long sur ceux qui dirigent ou qui ont été mis au pouvoir, faible d'esprit, manipulé, pour accomplir un vaste plan machiavélique de destruction jusqu'au dernier jugement atomique, pour la perte de biens des âmes qui n'auront fait un travail sur eux, sincères, honnête, noble..... !!!
Comme toute bonne civilisation qui atteins un seuil de technologie sans aucune sagesse, conscience.
En ce qui concerne le véritable Dernier jugement du Créateur, cela se fera à la "sortie" des esprits divisés (symbole du cerveau) des corps mortels (ce que nous pensons être, instrument que l'esprit divisé a fait dans ses efforts pour se tromper lui-même), pour certainement revenir dans la lessiveuse (plan temporel terrien) du recyclage KARMIQUE (actions passées !).
Des intellos ayant perdu la raison, la santé d'esprit !!!