Comment: Histoire de ne pas oublier que ce qui semble être devenu normal ne l'est en fait absolument pas, voici un petit résumé de la situation, ici, en France, pays des droits de l'homme et des libertés d'expression... théoriques. Où l'on apprend que, légalement, le gouvernement peut tout interdire ; il peut débarquer chez nous n'importe quand et n'importe comment, s'il flaire du potentiel "terroriste" ; il peut nous empêcher de nous déplacer ; il peut nous empêcher de voir qui l'on a envie de voir pour parler de ce dont on a envie de parler ; il peut même nous punir sévèrement pour délit d'intention, de mauvaises pensées. Ainsi agit la classe politique, devenue "terrorisée" par les citoyens de son propre pays.
Le 20 mai 2016, l'état d'urgence était prolongé de deux mois supplémentaires pour assurer la sécurité de l'Euro 2016. Si l'état d'urgence est légitime lorsque les mesures d'exception qui en découlent sont en lien avec le motif précis pour lequel il a été décrété, toute application hors de ce cadre est condamnable au nom des libertés fondamentales.
En donnant plus de pouvoirs aux juridictions administratives, au détriment du principe de séparation des pouvoirs, l'état d'urgence accorde toute-puissance au pouvoir exécutif. Depuis la loi du 20 novembre 2015, le gouvernement peut, dans un certain nombre de cas, mettre en suspens la liberté de circulation, de manifestation, d'expression, d'association.
Une porte ouverte à de nombreuses dérives si l'on fait l'effort de se rappeler que le pouvoir, aussi démocratique soit-il, ne s'auto-limite jamais. Et le risque de voir ces mesures d'exceptions s'avérer contre-productives, en privilégiant le court-terme et en abandonnant, sous la menace, des principes qui sont nos valeurs.
Du caractère exceptionnel de l'état d'urgence
Dans une démocratie, l'état d'urgence est par hypothèse un état d'exception. Il autorise de façon limitée - dans le temps et dans l'espace - des pratiques qui, tout en restant dans le cadre de l'état de droit, permettent l'affirmation d'une autorité et d'une puissance de nature à combattre une menace pour le régime politique en place ou pour la société tout entière.
Dans cet état d'exception, les deux principales conditions de l'exercice du pouvoir en démocratie — la règle de droit et la séparation des pouvoirs — ne sont pas suspendues stricto sensu, mais se voient adjoindre un troisième critère, celui de la puissance.
Ainsi, en théorie, l'état d'urgence n'ouvre-t-il pas un espace de non-droit, mais une période dans laquelle le concept wébérien de violence légitime atteint un seuil supplémentaire. Les garanties traditionnellement offertes dans un état de droit sont amoindries dans l'état d'exception, mais cette mise entre parenthèses doit demeurer autorisée par la loi et contrôlée sinon par le juge, du moins par le parlement.
Institué par la loi du 3 avril 1955 suite aux attentats perpétrés par le FLN sur le territoire algérien, l'état d'urgence « à la française » répond initialement à une situation de conflit armé sans officialiser le terme de guerre, ôtant ainsi aux indépendantistes algériens la qualité de soldats. Il a été utilisé sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie en 1985 dans un cadre similaire. En 2005, l'instauration de l'état d'urgence sur l'ensemble de l'Île-de-France ainsi que dans vingt agglomérations répond à une situation d'urgence sociale à la suite des émeutes survenues dans les banlieues.
Dans la période actuelle, la mise en œuvre de l'état d'urgence en France pose les questions suivantes : les mesures autorisées relèvent-elles d'un simple amoindrissement ou d'une négation des principes démocratiques ? et surtout, sont-elles de nature à apporter une réponse efficace à la menace combattue ? C'est dire, outre l'inquiétude légitime qu'il suscite par sa banalisation, pour reprendre l'expression de Denis Salas[1], que l'état d'urgence soulève des questions touchant aux libertés individuelles, à la séparation des pouvoirs, à son inscription dans le cadre d'une démocratie ainsi qu'à l'adéquation de cette réponse aux problématiques soulevées par le terrorisme djihadiste.
Mis en place pour douze jours suite aux attentats du 13 novembre 2015, l'état d'urgence a été prorogé par la loi trois fois depuis son instauration : le 20 novembre, le 19 février, et enfin le 20 mai, afin de couvrir la période de l'Euro 2016 qui se déroule en France.
L'exécutif tout-puissant
Élargi dans ses conséquences par la loi du 20 novembre 2015, l'état d'urgence autorise principalement les mesures suivantes :
- Les préfets peuvent interdire sous forme de couvre-feu la circulation des personnes ou des véhicules. Ils peuvent instituer « des zones de protection ou de sécurité où le séjour des personnes est réglementé » et interdire de séjour « toute personne cherchant à entraver, de quelque manière que ce soit, l'action des pouvoirs publics » ;
- Le gouvernement peut dissoudre les associations « qui participent à la commission d'actes portant une atteinte grave à l'ordre public », et le ministre de 'l'intérieur et les préfets peuvent « ordonner la remise des armes de catégories B et C » ;
- Le ministre de l'intérieur et les préfets peuvent « ordonner la fermeture provisoire des salles de spectacle, débits de boissons et lieux de réunion » et interdire « les réunions de nature à provoquer ou à entretenir le désordre », en particulier les manifestations ;
- En outre, aux termes de la loi de 2015, l'assignation à résidence prévue par la loi de 1955 s'applique non plus seulement aux personnes dont « l'activité s'avère dangereuse pour la sécurité et l'ordre public », mais est élargie aux personnes fournissant des « raisons sérieuses de penser que le comportement constitue une menace pour la sécurité » ;
- La loi de 2015 autorise également le blocage par l'exécutif des sites internet « provoquant à la commission d'actes de terrorisme ou en faisant l'apologie » ;
- Enfin, jusqu'au 26 mai 2016, le ministre de l'intérieur et les préfets pouvaient ordonner des perquisitions administratives à domicile « de jour et de nuit », à la seule charge d'en informer le procureur de la République.[2]
À ce titre, la commission des lois du Sénat a institué, le 25 novembre 2015, un « comité de suivi de l'état d'urgence » composé de six membres (un représentant de chaque groupe) ; le Sénat lui a attribué les prérogatives des commissions d'enquête.
À l'Assemblée nationale, la commission des lois a mis en place, le 2 décembre 2015, un dispositif de « veille parlementaire continue » de l'application de la loi du 20 novembre 2015 qui recensera chaque semaine les mesures qu'elle autorise (assignations à résidence, perquisitions, etc.), ainsi que leurs suites administratives et judiciaires. À cette fin, la commission a obtenu, pour la première fois à l'Assemblée, les prérogatives des commissions d'enquête.
À la faveur d'une question prioritaire de constitutionnalité transmise par le Conseil d'État[3], le Conseil constitutionnel a en outre soumis les assignations à résidence à un contrôle de proportionnalité entre la mesure et l'objectif recherché. Mais le juge constitutionnel s'est pour ainsi dire arrêté au milieu du gué en attribuant la compétence de ce contrôle non pas à l'autorité judiciaire, pourtant gardienne de la liberté individuelle aux termes de la Constitution, mais au juge administratif.
Reste que le terrorisme, qui connaît peu de limites dans l'espace comme dans le temps, nous pose face à cette contradiction : pour défendre nos libertés, il faut entrer dans le domaine de la protection armée ; comment dès lors faire du droit un moyen d'action et non plus un frein à l'action politique ?
Face à ce que Gilles Kepel qualifie de « troisième génération du djihad »[4], les réactions politiques des sociétés occidentales ont connu une rhétorique sécuritaire, voire guerrière, avec l'arrivée d'actes terroristes sur leur territoire. La France fait figure de cas d'école : entre 1986 et 2015, pas moins de vingt-et-une lois anti-terroristes ont été promulguées par les gouvernements successifs, de gauche comme de droite.[5]
L'état d'urgence, dans son émanation actuelle, relève du même type de réaction. Mais selon la commission parlementaire chargée de son contrôle, seules quatre procédures judiciaires ont été ouvertes à ce jour, pour plus de trois mille perquisitions et près de quatre cents assignations à résidence.
Face à un si faible bilan, comment sortir du « paradigme de l'exception »[6] ?
Notes :
[1] Denis Salas, « La banalisation dangereuse de l'état d'urgence », Études 2016/3 (Mars).
[2] Les perquisitions administratives ont en effet été abandonnées dans la dernière prolongation de l'état d'urgence.
[3] Décision du 22 décembre 2015 : « Le juge administratif est chargé de s'assurer que cette mesure est adaptée, nécessaire et proportionnelle à la finalité qu'elle poursuit ».
[4] Gilles Kepel, Terreur dans l'Hexagone : Genèse du djihad français, Gallimard, 14 décembre 2015
[5] Direction de l'information légale et administrative, Trente ans de législation antiterroriste, 21 janvier 2015 (http://www.vie-publique.fr/chronologie/chronos-thematiques/trente-ans-legislation-antiterroriste.html)
[6] Bernard Manin, « Le paradigme de l'exception », La vie des idées, 15 15 décembre décembre 2015


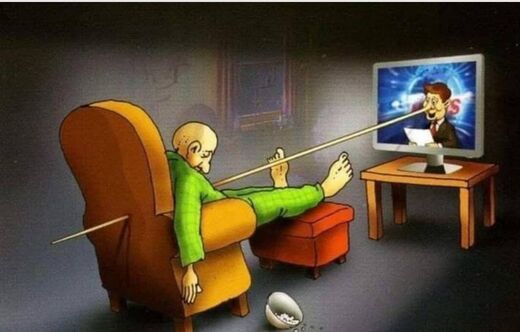

Thierry Theller:Attachez vos ceintures et... lisez jusqu'au bout.
La "mayonnaise" tant attendue commence à prendre...
Le vent mauvais de l'état d'urgence, commence à tourner...
Du coup, y'a comme du mouron dans l'air... pour le IVe Reich européiste !
Source : Laurent Freeman - Stop Mensonges
Bonjour à tous,
Je suis Lieutenant de POLICE CRS, en activité.
À plusieurs reprises j’ai songé METTRE FIN À MES JOURS et puis j’ai renoncé … Pour mes enfants.
Si vous avez la curiosité de lire un long exposé, vous comprendrez ce qui me motivait à envisager cet acte désespéré. Puisqu’il est maintenant totalement exclu que je me suicide, j’ai rédigé un texte POUR TENTER DE VOUS RÉVEILLER.
Pour bien mesurer ce qui fait le côté « exceptionnel et risqué » de ce qui va suivre, je dois préciser que Mes collègues et moi-même sommes « DRESSÉS » pour exécuter les instructions SANS même PENSER.
Chez nous, commencer à RÉFLÉCHIR c’est DÉSOBÉIR.
J’ai désobéi, j’ai réfléchi et NE PEUX PAS DONC NE VAIS PAS
affronter des citoyens Français qui veulent défendre NOS INTÉRÊTS.
Je préfère me retourner et DÉMISSIONNER.
________________________________________
Le texte qui va suivre a déjà été diffusé et vu plus de 148 000 fois.
Alors, évidemment, les réactions, nombreuses, ont défilé.
Lire la suite de l’article sur : [Lien]