La tension que recèle l'expression, due à Claude Vigée : « La joie malgré tout, la joie sur le fil du rasoir », atteint son apogée dans les pages qui décrivent cette « vie bouleversée » : « ... j'ai ma force intérieure et cela suffit, le reste est sans importance » Claude Vigée, dans « Secourir Dieu dans la Shoah : l'épreuve d'Etty Hillesum » (Etty Hillesum, « histoire de la fille qui ne savait pas s'agenouiller »), parle de l'« optimisme paradoxal » de cette jeune femme, née le 15 janvier 1914 aux Pays-Bas et qui avait donc vingt-cinq ans quand la guerre éclata et que commença, très vite, la persécution de la communauté juive.
Tout au long des pages de son journal, Etty Hillesum affirme la puissance de cette intériorité dont Kierkegaard fait le fondement de l'individu. « ... je me recueille en moi-même. Et ce « moi-même », cette couche la plus profonde et la plus riche en moi où je me recueille, je l'appelle « Dieu ». » Mais cette intériorité constitue aussi, pour le philosophe danois, une résonance, d'être à être, résonance que conquiert un sujet fondé en lui-même :
« Être à l'écoute de soi-même. Se laisser guider, non plus par les incitations du monde extérieur, mais par une urgence intérieure. Et ce n'est qu'un début. Je le sais. Mais les premiers balbutiements sont passés, les fondements sont jetés. »En cette correspondance avec son être intérieur, celle qui se recueille en son journal, trouve en elle-même déjà un interlocuteur et cette résonance subjective, « dédoublement salvateur de tout l'être » selon les mots de Claude Vigée , est un premier effort de résistance aux impositions du monde extérieur, de plus en plus cruelles.
Les Lettres de Westerbork (1942-43) sont écrites en majeure partie à Han Wegerif, chez lequel Etty vivait à Amsterdam, et aux occupants de sa maison, dont Maria Tuinzing, l'infirmière. Une longue lettre, datée de fin décembre 1942, s'adresse « A deux sœurs de La Haye », sur la demande du « docteur K », ou Herbert Kruskal probablement, nous dit en note Philippe Noble. Celle-ci, plus descriptive, est une sorte de présentation du camp de transit vers Auschwitz ou Sobibor, camp situé dans la lande à l'est de la Hollande :
« Toute l'Europe se change peu à peu en un immense camp. Toute l'Europe pourra bientôt disposer du même genre d'amères expériences. Si nous nous bornons à nous rapporter mutuellement les faits nus : familles dispersées, biens pillés, libertés confisquées, nous risquons la monotonie. Et les barbelés et la ratatouille quotidienne n'offrent pas matière à anecdotes piquantes pour les gens de l'extérieur - je me demande d'ailleurs combien il restera de gens à l'extérieur si l'Histoire continue à suivre longtemps encore le cours où elle s'est engagée. »Et, plus loin sur la même page :
« Je voulais dire en fait ceci : je ne suis pas poète et, de surcroît, je me sens assez désemparée devant cette promesse faite à K. Car si chargé d'émotion que soit pour nous le nom de Westerbork, ce nom qui continuera à résonner dans notre vie jusqu'à la fin de nos jours, je serais aujourd'hui encore bien en peine de savoir exactement que vous en dire. La vie qu'on y mène est tellement agitée, encore qu'il se trouvera sans doute beaucoup de gens pour soutenir qu'elle est au contraire d'une monotonie mortelle. »La « promesse faite à K » consistait à faire la chronique du camp de Westerbork.
Si une lettre, par nature, se tourne vers autrui, le journal n'est pas non plus fermé sur lui-même ; il n'est pas non plus seulement ce recueillement en soi-même évoqué plus haut. Au début, les préoccupations personnelles de son auteur, sur sa personnalité et sa sexualité, paraissent tout à fait celles d'une jeune femme de son âge, mais on voit par la suite se fonder entre ces pages cette « force intérieure » qui lui permettra d'affronter le pire en pleine conscience et sans haine.
Charles Juliet parle d'une « véritable mutation ». Claude Vigée, d'« une volte-face d'ordre psychique »
« On ne s'en rend pas soi-même encore très bien compte : on est devenu un être marqué par la souffrance, pour la vie. Et portant cette vie, dans sa profondeur insaisissable, est étonnamment bonne, Maria. J'y reviens toujours. Pour peu que nous fassions en sorte, malgré tout, que Dieu soit chez nous en de bonnes mains, Maria... » (Lettres)Il s'agit pour Etty Hillesum de conserver, en dépit de l'horreur et du chaos de la société humaine, une norme de la vie selon la vie, une norme de l'humain et de la joie : « Aujourd'hui, » écrit Claude Vigée, « une telle nostalgie de la joie peut paraître démente ou même scandaleuse aux yeux de philistins de tous bords. » Toutefois, la jeune femme assume sa position d'acceptation, et non de résignation (elle insiste à plusieurs reprises sur cet aspect), pour elle-même, et non pour les autres :
« Les gens ne veulent pas l'admettre : un moment vient où l'on ne peut plus agir, il faut se contenter d'être et d'accepter. Et cette acceptation, je la cultive depuis bien longtemps, mais on ne peut le faire que pour soi, jamais pour les autres. » (Lettres)Il en est de même pour l'acceptation de la mort :
« ... l'éventualité de la mort est intégrée à ma vie ; regarder la mort en face et l'accepter comme partie intégrante de la vie, c'est élargir cette vie. » (Journal)Ceci vaut pour soi, mais la mort des êtres chers demeure effarante, même si Etty écrit, au moment de la mort de son ami Julius Spier :
« Mes enfants, je suis pleine de bonheur et de gratitude, je trouve la vie si belle et si riche de sens. Mais oui, belle et riche de sens, au moment même où je me tiens au chevet de mon ami mort - mort beaucoup trop jeune - et où je me prépare à être déportée d'un jour à l'autre vers des régions inconnues. Mon Dieu, je te suis si reconnaissante de tout. » (Journal)Néanmoins, elle écrit plus loin : « C'est étrange comme on finit toujours par s'en remettre aux objets : Tide m'a donné ce petit peigne rose tout cassé qui lui appartenait. » Et le « petit peigne rose sale » témoigne dès lors de l'irréductible douleur de l'absence. Il dit très bien, en fait, qu'on n'accepte pas si facilement la mort de l'être cher :
« ... mais ce petit peigne rose sale avec lequel je l'ai vu pendant un an et demi mettre en ordre ses cheveux clairsemés, je l'ai serré dans mon portefeuille entre mes papiers les plus précieux, et je serais désespérée si je venais à le perdre. L'être humain est décidément une créature bizarre. »Dans son journal, Etty Hillesum s'adresse toujours à quelqu'un, à un tu qui met en scène le je qui parle. Si ce tu peut être tout simplement elle-même, ou bien son ami Julius Spier, il est le plus souvent Dieu lui-même. Tout comme le « petit peigne rose sale » était l'objet transitionnel (pour reprendre les termes du psychanalyste D.W. Winnicott) compensateur du deuil, le cahier sur lequel Etty écrit joue ce même rôle en fournissant l'espace potentiel pour un tel théâtre intérieur qui fasse contrepoint à l'horreur extérieure. Au-dehors, on nie les êtres, on casse les individus. Dans le cahier, Etty vient en aide à Dieu , c'est-à-dire qu'elle s'efforce, « sur le fil du rasoir », de maintenir le visage de l'individu et de sauvegarder de la sorte l'idée de la vie belle.
« Pour humilier, il faut être deux. Celui qui humilie et celui qu'on veut humilier, mais surtout : celui qui veut bien se laisser humilier. Si ce dernier fait défaut, en d'autres termes si la partie passive est immunisée contre toute forme d'humiliation, les humiliations infligées s'évanouissent en fumée. Ce qui reste, ce sont des mesures vexatoires qui bouleversent la vie quotidienne, mais non cette humiliation ou cette oppression qui accable l'âme. » (Journal)Le cahier pallie le défaut de relation au monde extérieur :
« Rien à faire, je dois recommencer à m'occuper de moi-même. Pendant quelques mois, j'ai pu me passer de ce cahier tant la vie en moi était claire, limpide et intense : contact avec le monde intérieur et extérieur, enrichissement, épanouissement de la personnalité. »C'est l'écriture, et donc le langage, qui fonde la résistance d'Etty à la destruction :
« Je dois m'efforcer de ne pas perdre contact avec ce cahier, c'est-à-dire avec moi-même, sinon j'aurai des problèmes. Je cours encore à chaque instant le risque de me perdre et de m'égarer, je le ressens vaguement en ce moment, peut-être seulement du fait de la fatigue. »Consciente du désespoir absolu de la situation « Pour nous, je crois, il ne s'agit déjà plus de vivre, mais plutôt de l'attitude à adopter face à notre anéantissement. », Etty Hillesum choisit de demeurer là, parmi les victimes. Elle refuse de se cacher ou d'entrer dans la résistance comme voulait l'en persuader Werner Stertzenbach, opposant actif au nazisme. Sa position, toutefois, n'est pas résignation. Elle écrit :
« On se berçait encore tellement de l'espoir puéril que ce convoi serait annulé ! D'ici, beaucoup avaient suivi le bombardement d'une ville voisine, peut-être Emden. Et pourquoi une voie ferrée n'aurait-elle pas été touchée, empêchant le train de partir ? Cela n'était jamais arrivé, mais, à chaque convoi, on se reprend à l'espérer, avec un optimisme indéracinable. »Elle s'interroge sur ce qu'elle fait :
« Mais, cette nuit, je vais habiller des bébés et tenter de calmer des mères et c'est cela que j'appelle « porter secours ». Je pourrais me maudire. [...] Mais que se passe-t-il donc, quelles sont ces énigmes, de quel fatal mécanisme sommes-nous prisonniers ? Nous ne pouvons nous tirer de ces contradictions en disant que nous sommes tous lâches. Et d'ailleurs nous ne sommes pas si mauvais. Nous nous trouvons ici en face de questions plus profondes... »Et c'est cela qu'elle cherche en demeurant parmi les siens : le sens profond de ce « mécanisme ». Comme elle le dit, l'entreprise frise le « démoniaque » :
« ... je voudrais, partout où je suis, susciter une timide fraternisation entre tous ces « ennemis » ; je veux comprendre ce qui se passe, et je voudrais que tous ceux que je pourrai atteindre (et ils sont légion, rends-moi la santé, mon Dieu !) comprennent les événements du monde à travers moi. »Ce qu'elle entend préserver, dans son journal et dans ses lettres, c'est la réciprocité entre les êtres, le contrepoint absolu du mécanisme qui n'engage plus que des objets.
« En fait, je n'ai pas peur. Pourtant, je ne suis pas brave, mais j'ai le sentiment d'avoir toujours affaire à des hommes, et la volonté de comprendre autant que je le pourrai le comportement de chacun. [...] J'aurais voulu commencer tout de suite un traitement psychologique, sachant parfaitement que ces garçons sont à plaindre tant qu'ils ne peuvent faire de mal, mais terriblement dangereux, et à éliminer, quand on les lâche comme des fauves sur l'humanité. Ce qui est criminel, c'est le système qui utilise des types comme ça. » (Journal)Elle parle là d'un membre de la Gestapo lors d'une convocation à laquelle elle s'était rendue.
Si elle dit qu'il faudrait être poète pour faire la chronique de Westerbork, c'est bien parce que ce qu'elle appelle « aider Dieu » est une tâche qui concerne, au bout du compte, le langage.
« Je ne me fais pas beaucoup d'illusions sur la réalité de la situation et je renonce même à prétendre aider les autres ; je prendrai pour principe d'« aider Dieu » autant que possible et si j'y réussis, eh bien je serai là pour les autres aussi. Mais n'entretenons pas d'illusions héroïques sur ce point. »Cette « dilatation » dont elle parle (pp. 90-91), cette joie qu'elle maintient d'un bout à l'autre devant la vie, émane de sa capacité à préserver un langage d'être à être, toujours renouvelé dans l'instant : « Recommencer, ce n'est pas du jeu. On tombe dans le cliché. » Elle vise aussi un langage qui ne soit pas bouffissure de soi :
« Cet après-midi, regardé des estampes japonaises avec Glassner. Frappée d'une évidence soudaine : c'est ainsi que je veux écrire. Avec autant d'espace autour de peu de mots. Je hais l'excès de mots. Je ne voudrais écrire que des mots insérés organiquement dans un grand silence, et non des mots qui ne sont là que pour dominer et déchirer ce silence. En réalité les mots doivent accentuer le silence. »Ces mots du langage vrai montent du puits de l'âme :
« Il y a en moi un puits très profond. Et dans ce puits, il y a Dieu. Parfois je parviens à l'atteindre. Mais plus souvent, des pierres et des gravats obstruent ce puits, et Dieu est enseveli. Alors il faut le remettre au jour. »C'est pourquoi cette écoute de soi est une quête de connaissance : « On cherche toujours la formule libératrice, la pensée clarificatrice. » Dans cette profondeur se tisse l'humain. Etty s'adresse à son ami mort :
« Tu as la chance de ne plus avoir à souffrir avec moi, mais je suis de taille à affronter un peu de froid et un peu de barbelés, et je prolonge ta vie. Ce qui en toi était immortel, je le prolonge dans ma vie. »Au tréfonds de la douleur, « aider Dieu » : « en soi-même ces sources originelles que j'ai choisi d'appeler Dieu », c'est se cramponner au langage vrai :
« Je voudrais pouvoir venir à bout de tout par le langage, pouvoir décrire ces deux mois passés derrière les barbelés, les plus intenses et les plus riches de ma vie, et qui m'ont apporté la confirmation éclatante des valeurs les plus graves, les plus élevées de ma vie. J'ai appris à aimer Westerbork, et j'en ai la nostalgie. »Cette authenticité se définit comme adéquation à la source subjective (la « passion », pour employer le terme de Kierkegaard, ou « l'éprouvé de la vie », comme le dit Michel Henry). « Oser à fond être soi-même, » prône le philosophe danois, « oser réaliser un individu, non tel ou tel, mais celui-ci, isolé devant Dieu, seul devant l'immensité de son effort et de sa responsabilité » (Traité du désespoir). Etty Hillesum écrit :
« ... tout progresse selon un rythme profond propre à chacun de nous et l'on devrait apprendre aux gens à écouter et respecter ce rythme : c'est ce qu'un être humain peut apprendre de plus important en cette vie. » (Lettres)Ce langage ancré dans le rythme le plus profond de chacun se définit aussi comme garant du lien entre les êtres : « Papa veut employer son jour de correspondance pour t'écrire, mais il se peut que le courrier soit retenu. Enfin, de petites tracasseries ne réussiront pas à briser les liens qui existent entre les êtres. »
C'est cet effort paradoxal qui permet à Etty d'être « toujours aussi radieuse ». C'est aussi sa capacité à voir toujours l'être humain derrière la haine ou l'humiliation qui lui fait trouver la réplique quand il le faut
: « Il faut assumer tout ce qui vous assaille à l'improviste, même si un quidam revêtant traîtreusement la forme d'un de vos frères humains fond droit sur vous au sortir d'une pharmacie où vous avez acheté un tube de dentifrice, vous tapote d'un index accusateur et vous demande avec un air d'inquisition : « Vous avez le droit d'acheter dans ce magasin ? » Et moi de répondre, un peu timidement mais avec fermeté et avec mon amabilité habituelle : « Oui, monsieur, puisque c'est une pharmacie. » - « Ah bon », fit-il, sec et méfiant, avant de passer son chemin. » (Journal)Elle appelle cet effort de préservation du langage malgré le règne réifiant de la haine : « vivre en poète cette vie-là » et elle sait trouver la « pensée clarificatrice » qui fait du lecteur non pas un voyeur se repaissant de l'horreur qu'on inflige aux autres, mais un être humain tentant de comprendre, avec celle qui a vécu ce chaos, le mécanisme de dérégulation absolu des rapports humains, et nous la prenons très au sérieux quand elle dit :
« Mon Dieu, cette époque est trop dure pour des êtres fragiles comme moi. Après elle, je le sais, viendra une autre époque beaucoup plus humaine. J'aimerais tant survivre pour transmettre à cette nouvelle époque toute l'humanité que j'ai préservée en moi malgré les faits dont je suis témoin chaque jour. C'est aussi notre seul moyen de préparer les temps nouveaux : les préparer déjà en nous. »Même si elle sait qu'il faudra rapporter ces faits, elle s'abstient de la description spectaculaire et morbide de la cruauté, qui ne donne pas une conscience plus vive du mal et ne permet pas de lutter, mais contraint à y participer.
« Un soir, il [Max Witmondt] fit le récit détaillé des tortures qu'il avait subies. D'autres que moi relateront un jour ces pratiques dans toutes leurs finesses ; il le faudra probablement pour transmettre à la postérité l'histoire complète de cette époque. Mais ces détails ne sont pas pour moi, je n'en ai pas besoin. »Ce langage n'est ni aveugle ni sourd. Il est l'être lui-même. Sans grandes théories littéraires, même si elle est une grande lectrice (Dostoïevski, Jung, Saint Augustin, Michel-Ange, Léonard de Vinci, Rilke, Shakespeare, Kierkegaard, entre autres), mais dans les plus grandes souffrances, Etty Hillesum a vraiment réfléchi sur la source de l'engagement et de la joie poétiques - bien au-delà de ce qui limite le poème à n'être qu'un objet esthétique.
Claude Vigée écrit :
« A travers ces lignes perturbantes écrites avec le feu et le sang en temps d'apocalypse, se révèle à nous un être fait d'excès, dans la substance duquel coïncident, selon l'enseignement des Correspondances de Baudelaire, les puissances de l'esprit et celles des sens demeurés en éveil jusqu'à la fin, sans nul divorce de la pensée et du sentiment. Ne sont-ce point là les qualités majeures d'un écrivain ? »Je terminerai en citant deux « formules » extraites des lettres, qui me paraissent établir cette réciprocité entre les êtres, cette dimension d'intériorité :
« Il y a de la boue, tant de boue qu'il faudrait avoir un soleil intérieur accroché entre les côtes si l'on veut éviter d'en être psychologiquement victime. »En même temps, perce là un certain humour, qu'elle désire. Par exemple, elle l'admire chez son père :
« Il a un humour fondamental qui s'approfondit et pétille d'autant plus que le grotesque processus de clochardisation où il est engagé prend des proportions plus catastrophiques. »N'oublions pas que pour Kierkegaard, l'humour est le passage au paradoxe existentiel du « chevalier de la foi ». « Les vrais, les grands soucis ont totalement cessé d'en être - ils sont devenus un Destin auquel on est désormais soudé. »
Cependant, face à l'effondrement des lois humaines, le langage d'Etty permet tout de même de témoigner d'un monde en lequel la vie n'a cessé d'exister selon ses normes propres :
« ... et je vais de temps à autre rendre visite aux mouettes, dont les évolutions dans les grands ciels nuageux suggèrent l'existence de lois, de lois éternelles d'un ordre différent de celles que nous produisons, nous autres hommes. »C'est ce hiatus que manifeste la seconde formule, qui me servira de conclusion :
« Les wagons de marchandise étaient entièrement clos, on avait seulement ôté çà et là quelques lattes et, par ces interstices, dépassaient des mains qui s'agitaient comme celles de noyés.
Le ciel est plein d'oiseaux, les lupins violets s'étalent avec un calme princier, deux petites vieilles sont venues s'asseoir sur la caisse pour bavarder, le soleil m'inonde le visage et sous nos yeux s'accomplit un massacre, tout est si incompréhensible.
Je vais bien.
Affectueusement,
Etty. »
Ouvrages cités :
- Etty Hillesum, Une vie bouleversée, suivi de Lettres de Westerbork. Traduit du néerlandais et présenté par Philippe Noble. Paris : Points Seuil, 2004.
- Charles Juliet, Dominique Sterckx et Claude Vigée, Etty Hillesum, Histoire de la fille qui ne savait pas s'agenouiller. Préface de Liliane Hillesum. Paris : Arfuyen, 2007.
- Kierkegaard, Miettes philosophiques, Le concept d'angoisse, Traité du désespoir. Traduit du danois par Knud Ferlov et Jean-Jacques Gateau. Paris : Tel Gallimard, 2003.
« L'éventualité de la mort est intégrée à ma vie ; regarder la mort en face et l'accepter comme partie intégrante de la vie, c'est élargir cette vie. A l'inverse, sacrifier dès maintenant à la mort un morceau de cette vie, par peur de la mort et refus de l'accepter, c'est le meilleur moyen de ne garder qu'un pauvre petit bout de vie mutilée, méritant à peine le nom de vie. Cela semble un paradoxe : en excluant la mort de sa vie, on se prive d'une vie complète, et en l'accueillant on élargit et on enrichit sa vie. »
- Etty HILLESUM, Une vie bouleversée
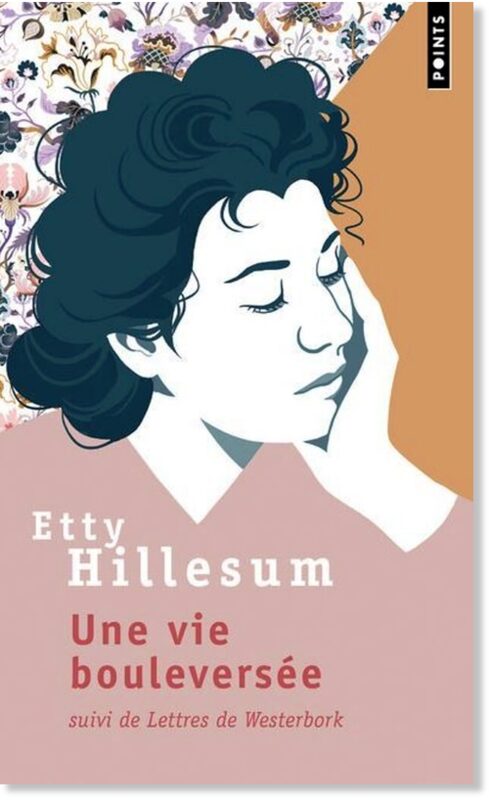







Commentaires des Lecteurs
Lettre d'Information