Commentaire : Si la possible parkinsonienne Clinton arrive au pouvoir, verrons-nous également le monde sombrer, irrémédiablement, à l'image du pronostic vital fatalement engagé avec ce type de maladie ? Malheureusement pour nous, c'est bien possible.
Hillary Clinton incarne cette prétention narcissique à dominer le monde et à s'approprier ses ressources. Les trois présidents précédents n'ont fait que la moitié du travail, elle compte faire le reste.
Les États-Unis sont un pays formidable où les élites ne doutent de rien. Ces hyper-nantis voient le monde à travers leur portefeuille et n'imaginent pas une seconde qu'on puisse faire autrement. Leur cupidité illimitée s'accompagne d'une bonne conscience en granit qui les persuade qu'ils font le bien en se remplissant les poches. S'ils croient à l'économie de marché comme ils croient en la providence, c'est parce qu'à leurs yeux, c'est du pareil au même. Leur domination est dans l'ordre des choses, garantie pour l'éternité par le dieu dollar.
Cette idée simple procure à « l'Amérique » la profession de foi d'un culte narcissique. Hypnotisée par sa propre image, elle idolâtre sa puissance et s'attribue la force du juste. Une « destinée manifeste », dit-elle, la voue à guider l'humanité. Brandissant les droits de l'homme, elle sème généreusement les graines de la démocratie et du marché. Mais cette générosité à l'égard de l'Ukraine, par exemple, n'a rien à voir avec le fait que le fils du vice-président des États-Unis siège au conseil d'administration d'un consortium gazier ukrainien.
Loin d'être une anomalie passagère, le néo-conservatisme est l'accomplissement du « rêve américain ». Cette idéologie retorse est le point d'orgue d'un « exceptionnalisme » qui sanctifie toutes les transgressions. Pour ses élites, la vocation de « l'Amérique » est d'être au sommet du podium, elle est le phare qui prodigue une lumière bienfaisante aux nations reconnaissantes, dût-elle recourir, pour les convaincre, aux vertus pédagogiques des B 52.
Commentaire : A propos de cette croyance pathologique en un destin exceptionnel :
Hillary Clinton, aujourd'hui, incarne cette prétention narcissique à dominer le monde et à s'approprier ses ressources. Celle que Diana Johnstone appelle la « reine du chaos » est déterminée à restaurer le leadership de Washington sur les affaires planétaires. À grand renfort de rhétorique chauvine, elle galvanise les énergies du complexe militaro-industriel, du lobby sioniste et de la haute finance. Les trois présidents précédents n'ont fait que la moitié du travail, elle compte faire le reste.
Car, depuis 1992, la continuité l'a emporté sur le changement. Ce n'est pas George W. Bush qui a inféodé la politique de son pays aux intérêts des majors pétrolières et des magnats de l'armement. Elle l'était déjà. Prototype du guerrier pacifiste, son prédécesseur, Bill Clinton, y a largement contribué. Il a légué un héritage politique dont son âme damnée entend désormais faire fructifier les acquis.
L'élection du candidat démocrate eut lieu au lendemain de l'effondrement de l'URSS. Cette disparition de la bipolarité était propice à de nouvelles avancées hégémoniques. Poussé par « l'État profond », cette coalition des multinationales, des banques et des officines clandestines qui pilote en sous-main la politique du pays, le nouveau président conforta la domination sans partage de Washington. Bill Clinton n'a pas inventé la politique impériale, mais il l'a étendue à la planète.
Commentaire : A propos de « l'État profond » :
La première avancée fut la transformation de l'Otan en machine de guerre agressive. Bras séculier d'une alliance défensive destinée à parer à la « menace soviétique », cet appareil guerrier survécut à son ennemi potentiel. Au lieu de le dissoudre, les dirigeants US en firent le corset des nations occidentales et l'instrument d'une offensive contre Moscou. Élargie aux pays de l'Est européen, l'alliance eut tôt fait d'atteindre les frontières occidentales de la Russie.
La deuxième avancée était de nature idéologique. Pour justifier l'intervention militaire contre un État souverain, on invoquerait désormais les droits de l'homme. Cette doctrine fut expérimentée dans les Balkans, où la propagande humanitaire servit de paravent à l'ingérence dans les affaires intérieures de la Serbie. On inventa au Kosovo un génocide qui n'eut jamais lieu, on bombarda les infrastructures serbes, puis on confia le service après-vente de ce désastre à Bernard Kouchner.
Cette opération eut pour résultat de créer un État voyou, livré clé en main à une mafia qui s'était mise au service de l'Occident pour préserver ses marges de profit. Pour la première fois, un État-croupion fut porté sur les fonts baptismaux par une intervention militaire de l'Otan, en l'absence de mandat onusien et en violation de la loi internationale. On croyait naïvement que l'intangibilité des frontières était un principe de droit international. C'est fini.Le génie inventif de la présidence Clinton, enfin, porta sur la façon de faire la guerre. Avec les bombardements infligés à l'Irak et à la Serbie, le Pentagone expérimenta une « révolution dans les affaires militaires ». Au lieu d'expédier des troupes risquant de se faire hacher menu, Washington frappa ses ennemis en déchaînant le feu céleste. D'une parfaite asymétrie, les frappes chirurgicales cumulaient les avantages de l'ubiquité, de la précision et de l'absence de pertes dans le camp du bien.
Avec ces trois innovations, le paradigme Clinton fournit un modèle inoxydable de politique étrangère. Ni George W. Bush ni Barack Obama n'y ont dérogé. Le premier adopta après le 11 septembre 2001 un interventionnisme brouillon qui fit l'effet d'un éléphant dans un magasin de porcelaine. Secoué par le fiasco irakien, le peuple américain élut en 2008 un démocrate plutôt avenant qui avait pour carte de visite son opposition à cette aventure guerrière. Mais l'illusion fut de courte durée, et la politique néo-conservatrice continua de plus belle.
Barack Obama, il est vrai, a signé un important accord avec l'Iran et entamé le dialogue avec Cuba. Il a évité l'envoi de troupes sur le champ de bataille, préférant le « leading from behind » à l'intervention directe. Mais il a intensifié la sanglante guerre des drones et maintenu le bagne extra-légal de Guantanamo. Jouant avec le feu, il a poursuivi la déstabilisation de petits États qui ne marchandent pas leur souveraineté, comme la Libye et la Syrie. Face à l'Est, il a comparé la Russie à Daech et Ebola, il a installé un bouclier antimissile qui menace Moscou, favorisé un coup d'État à Kiev et imposé à la Russie, qui n'agresse personne, des sanctions inutiles.
La campagne électorale d'Hillary Clinton montre que les élites dirigeantes du pays entendent poursuivre cette politique agressive. Si jamais elle l'emporte face à Donald Trump, le « paradigme Clinton » a de beaux jours devant lui. La candidate démocrate est fière comme un Artaban de son bilan en Libye et décidée à liquider Bachar al-Assad. L'« Amérique » dont elle promet le retour veut conjurer à tout prix l'émergence d'un monde multipolaire. Le « capitalisme portant en lui la guerre comme la nuée l'orage » (Jaurès), cette obstination n'est pas de bon augure.



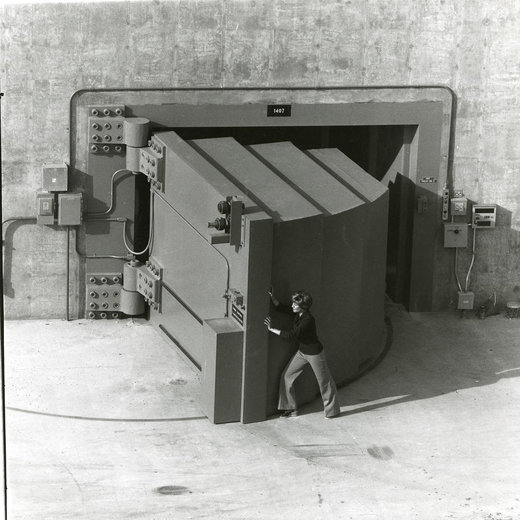
Commentaires des Lecteurs
Lettre d'Information