Immense auteur français de la première moitié du XXᵉ siècle, normalien, grand voyageur, pianiste, poète, dramaturge, penseur, philosophe, André Suarès, par ses engagements contre la laideur totalitaire et en faveur de la beauté et de l'esprit, est à lire ou relire de toute urgence.
Partie 1 : La lutte contre les totalitarismes et l'invitation au voyage
« À mes yeux, il n'y a de supériorité que dans l'esprit. Et la grandeur spirituelle ne va pas, ne peut pas aller sans la bonté, sans la caritas du genre humain, comme dit Saint-Paul. » (Suarès, Vues sur l'Europe.)Lorsqu'Hitler accéda au pouvoir, bien peu furent les intellectuels à dénoncer sa politique et sa folie, et à prendre la mesure du danger qu'il représentait. Si Hannah Arendt s'enfuit très rapidement d'Allemagne (« J'ai immédiatement pensé que les Juifs ne pourraient pas rester »[1]), Günther Anders, son premier mari, témoigna de son côté s'être heurté à une incrédulité massive, même chez les intellectuels qui ne soutenaient pas Hitler et le nazisme :
Amor che nella mente mi ragiona Amour, la raison de mon âme (Dante)
« J'ai d'ailleurs organisé des discussions sur ces problèmes dès l'automne 1932 avec celle qui était ma femme l'époque, et qui était beaucoup plus versée que moi in judaicis[2] [...]. Il s'agissait d'un séminaire que j'avais organisé chez moi à Berlin. Le sujet en était à vrai dire Mein Kampf, le livre de Hitler. Mettre ce séminaire sur pied ne fut pas simple. Car les intellectuels que j'avais sollicités se refusèrent dans un premier temps à prendre au sérieux une pareille "saloperie". Et cela prit un bon moment pour leur faire comprendre que rien n'était plus dangereux qu'une "saloperie" bien ficelée sur le plan rhétorique. J'aurais eu moins de mal à battre le rappel pour un séminaire sur Hegel. »Non seulement ces intellectuels ne furent pas légion, mais les rares à s'inquiéter de Hitler furent mis au ban et raillés, dont Anders et Suarès :
« je savais que Hitler allait signifier guerre mondiale (je m'étais ridiculisé, en France, avant 1933, en risquant ce pronostic). »[3]Il nous faut donc rendre hommage non seulement au courage, mais encore à la lucidité et au caractère visionnaire des happy few qui surent voir le danger bien avant tout le monde au début des années 1930. André Suarès fait partie de ceux-là. Né à Marseille le 12 juin 1868, et décédé le 7 septembre 1948, Isaac Félix Suarès, dit André Suarès, fut une grande figure intellectuelle de son temps. Son père était un négociant juif de Gênes, et sa mère, issue de la bourgeoisie israélite, mourut alors que Suarès était encore enfant. Scolarisé au lycée Thiers de Marseille, il y obtint le prix d'excellence, ainsi que le premier prix au concours général de Français, et fut d'emblée remarqué par Anatole France. Stefan Zweig compta parmi les plus grands admirateurs de Suarès.
J'ai découvert son œuvre lorsque j'étais jeune adulte, à l'ENS de la rue d'Ulm qu'il avait aussi fréquentée, aux côtés de Romain Rolland. Il y échoua toutefois à l'agrégation d'histoire, ce qui lui traça une route d'intellectuel nomade, plus que d'enseignant conforme. En 1935, il obtint le grand prix de la société des gens de lettres, puis de littérature de l'Académie française. Il fut l'un des piliers de La Nouvelle Revue française, de 1912 à 1914, puis de 1926 à 1940, aux côtés d'André Gide, de Paul Valéry et de Paul Claudel. Jean Paulhan fut l'artisan de son retour à la Revue, d'où Suarès avait été banni par Jacques Rivière, qui l'avait pourtant défini comme l'un des cinq plus grands écrivains du début du XXe siècle. Par ses empreintes méditerranéennes, et en particulier helléniques, marseillaises et toscanes, je m'en suis naturellement sentie très proche, et son œuvre m'a toujours accompagnée.
Quelques années plus tard, après que j'eus lu Vues sur l'Europe, le destin m'a envoyée « coller » au Lycée Thiers à Marseille, à partir des années 2005 : j'y interrogeais à l'oral les élèves des classes préparatoires en prévision de leurs concours, et à chaque franchissement du seuil, j'avais une pensée pour Suarès. Il est donc grand temps pour moi de lui rendre un hommage public, et d'inciter les lecteurs à le lire ou le relire aujourd'hui. Car si la philosophe Hannah Arendt conserve sa notoriété post-mortem, André Suarès comme Günther Anders en revanche, demeurent des auteurs encore trop méconnus. L'heure est donc venue de réhabiliter l'œuvre de ces géants, à la lumière de ce que nous vivons aujourd'hui, et de rendre hommage à ce talent qui émane de leur intégrité. Il est assez évident pour moi que la caste des intellectuels bien-pensants français s'est rapidement employée à invisibiliser André Suarès, cet auteur tout à fait remarquable pour la finesse de sa pensée et son style littéraire, et ce, d'autant que ses engagements avaient mis en lumière leurs compromissions, dès le début des années 1930.
La vie comme mouvement
Quel point commun pourrions-nous trouver entre Günther Anders et André Suarès ? Tout d'abord, leur nom n'est toujours pas principal dans les discussions, comme s'il cachait une honte, celle d'avoir dénoncé le scandale à visage découvert, comme chacun d'entre eux l'a fait à sa manière. En approfondissant un peu leur pensée, il y a, chez ces deux auteurs, une valorisation de la vie comme mouvement. Günther Anders reconnut en effet avoir identifié très tôt une propension au nazisme chez Heidegger, par sa pensée philosophique du temps :
« Être figé dans le temps dans un lieu fixe n'augurait rien de bon, et était tout à fait compatible avec l'idéologie nazie : je lui faisais le reproche d'avoir laissé de côté chez l'homme sa dimension de nomade, de voyageur, de cosmopolite, de n'avoir en fait représenté l'existence humaine que comme végétale, comme l'existence d'un être qui serait enraciné à un endroit et ne le quitterait pas. [...] Je lui dis donc, à ce moment-là, le reproche de ne même pas accorder à l'homme la mobilité de l'animal [...] mais de considérer l'homme dans le fond comme un être enraciné, comme une plante, et j'insistai sur le fait qu'une telle anthropologie de l'enracinement pouvait avoir des conséquences politiques du plus mauvais augure. »[4]On se souvient en effet que tous les totalitarismes se plaisent à figer les êtres dans l'espace : passeports intérieurs, interdictions de déplacement, enfermement dans des camps, etc. Chez Suarès, la vie est mouvement. Bercé par la Méditerranée, il accomplit son premier voyage en Italie, de juin à septembre 1895, à pied. Il y retournera plusieurs fois, de septembre à novembre 1902, de mai à août 1909, en 1913, puis en 1928. Il retira de ses pèlerinages en terres italiennes son œuvre, le Voyage du condottiere, dans lequel il s'attacha à définir les villes selon leur âme propre, se guidant à partir de ses sensations, mais aussi des hauts esprits et artistes les ayant habitées, et parfois, conquises : Dante, Piero della Francesca, Fra Angelico, Leonard de Vinci, Botticelli, Michel-Ange, Véronèse, Titien, etc.
Éternel voyageur, Suarès conçoit sa liberté dans le voyage, mais ce voyage n'est pas simplement extérieur : tout voyage est une provocation, celle d'un voyage initiatique, intérieur.
C'est que Suarès embrasse et parcourt les villes italiennes comme le corps de ses amantes : Sienne l'ardente qui délivre un « baiser dans un sourire mystique », Venise la tentatrice, tendre, mélancolique et féérique, Florence, cette « grande dame, si fine et si courtoise », « secrète aussi »... « Il faut entrer dans Florence, à vingt ans, sur le tard de la nuit, et recevoir l'aube en fleurs, d'une lèvre amoureuse. » Car c'est bien Florence, le berceau de la Toscane, qui procure à Suarès son plus grand saisissement, un « élan presque divin », « la fleur exquise de l'esprit », « la région la plus heureuse de l'intelligence » : « Une émotion de l'ordre le plus pur, celle qui se connaît elle-même à mesure qu'elle s'éprouve et qui s'épure de toute faiblesse sentimentale, telle est mon épreuve de Florence. » Florence est à ses yeux la « perfection d'un monde clos », dont « la recherche de la beauté fait la pure ardeur et le génie de cette ville. »
La Grèce comme refuge et comme idéal
Rien n'est cloisonné, car tout est absolument habité chez Suarès : philosophie, science, poésie, politique, peinture, danse, musique, amour. Tout y est passion et recherche avide de l'âme vers ses furieux transports. L'invitation au voyage est une exhortation de l'âme, l'antidote au nazisme et, plus globalement, au fait totalitaire. L'idéal chez Suarès est double : celui de la beauté hellène, puis celui, artistique, de la Renaissance italienne. De 1922 à 1929, Suarès échangea ainsi une centaine de lettres avec le grand sculpteur Antoine Bourdelle, dans lesquelles, à propos des temples, Suarès expliquait à son ami :
« La vraie beauté est ce qui dure, ce qui est fixé dans ses proportions justes, une fois pour toutes, où les nombres de l'esprit sont arrêtés dans la plus belle forme qu'il leur soit donné d'atteindre, celle qui les accomplit et les révèle du même coup » (lettre du 21 novembre 1923).Mais il demeure dans cette aspiration artistique, en particulier florentine, quelque chose d'encore trop figé. Homme de la Méditerranée, de Marseille à Florence en passant par Athènes, Suarès cherche avant tout le mouvement de la vie pure, celle qui s'oppose au péril totalitaire : la dolce vita, l'histoire, le farniente, le plaisir, l'amour, l'amitié, la création artistique, la beauté, en quelques mots, le foisonnement de l'esprit. Suarès voyage pour sentir l'incarnation de l'âme des lieux. De son œuvre, le lecteur comprend que le voyage n'est qu'un subterfuge pour faire lever le voile du voyage intérieur. En 1925, l'écrivain demandait à Madame Bourdelle de l'accompagner en Grèce :
« On m'invite à faire le voyage en Grèce. Si vous voulez en être, je pars pour Athènes avec vous... Vraiment, mon sort se joue en ce moment : c'est ma dernière chance de jamais voir l'Acropole et de contempler le monde, couché au pied d'une colonne du Parthénon. J'ai fait, l'autre jour, un songe d'une clarté éblouissante. J'ai vu le Lycabette comme une pierre d'argent et le Parthénon comme une fleur d'or vermeil. Et j'étais en mer, une mer violette, pailletée de diamants. Les dieux ont peut-être voulu m'avertir que je n'avais pas besoin d'aller en Grèce pour y être. »Pour y être, ou pour en être. Le voyage intérieur, notre aptitude à l'évasion imaginaire, est notre résistance au totalitarisme, notre lieu de liberté poétique intérieure. Il y a là un voyage qui n'est pas seulement géographique, mais aussi et surtout, spirituel et historique.
Pourtant, Suarès n'en avait pas encore fini avec la Grèce, et il y reviendra au sujet du nazisme : Athènes indique le nord de la boussole. Dès 1930, Suarès s'indigna devant les autodafés nazis contre l'œuvre de Heine, juif comme l'était Suarès. C'est qu'il avait flairé le danger, celui du « retour de la bête », notamment après avoir lu Mein Kampf:
« Dans ce livre, il y a tous les crimes de Hitler commis cette année, et tous ceux qu'il pourra commettre encore. Ils y sont, il les annonce, il s'en vante plus même qu'il ne les avoue. Il dit, en termes exprès, qu'il faut mettre le feu au Reichstag, et il l'a fait. Et vous cherchez encore l'incendiaire, le coupable ? [...] Il ne vous cache pas que le meurtre est un moyen politique, et des plus succulents ; que tout est bon à qui veut se défaire de son ennemi, qu'il s'agisse d'un individu ou d'un peuple. [...] Que faut-il de plus que ce livre ? Il confesse les intentions. Tout y est, et tout y aura été, quoi que cet homme fasse. Il serait bon que tous les Français le connaissent, et on les empêche de le lire. »Ses Vues sur l'Europe furent mises à l'écart, et ne paraîtront qu'en 1938. Elles ne réveilleront pas les Français endormis et inertes, et lui vaudront plutôt d'être poursuivi par la Gestapo et la milice, à partir de 1939. Le lecteur pourra, outre les Vues sur l'Europe, se référer à ses textes politiques contre le totalitarisme récemment compilés dans un ouvrage intitulé Contre le totalitarisme[5].
La Grèce Antique ne cessa de guider l'engagement de Suarès :
« la paix exige qu'on impose des limites aux forcenés qui sèment partout la guerre. »[6] Le 11 septembre 1939, le poète écrivit à Madame Bourdelle un message angoissé : « C'est Démosthène qui avait raison : il répétait sans cesse aux Athéniens qu'il ne faut jamais pactiser avec les Barbares. On ne l'a pas cru... Il y a toujours un Démosthène dans une Athènes ; mais il n'y a presque jamais un gouvernement pour l'entendre et le croire. »Face à cette irrémédiable montée des totalitarismes, Suarès célébra en contrepoint la poésie, la douceur de vivre méditerranéenne, en particulier en Provence, la grandeur de Marseille la bigarrée, plus sublime encore dans son émanation vivante que tous les chefs-d'œuvre de l'Italie :
« Jamais, écrit encore Suarès, je n'ai mieux senti qu'à Marseille, combien l'art est peu de choses au prix de la vie... La beauté de la vie l'emporte de tout le poids du monde réel sur la beauté de l'art et l'œuvre du génie... Rien n'est plus beau que ces chefs-d'œuvre éphémères, que l'action, l'amour, le plaisir ou le jeu font naître, et qui disparaissent avec l'heure. [...] Par un matin de pierre dure, au temps de Pâques, entre avril et mars, si tu peux rester debout sur le balcon de Notre-Dame- de-la-Garde, quand souffle le mistral et que l'équinoxe joue à la balle avec les bateaux sur la mer, tu fais, sans quitter le roc, la traversée de la tempête la plus sèche qui soit au monde. Regarde Marseille sortir du sommeil, secouer la première paresse qui suit le réveil, et se ruer à la vie de nouveau. Tiens-toi ferme à la rampe. Tu es sur le pont du plus haut bord entre tous les navires... Le ciel craque. La grande haleine éparpille le soleil en poudre d'or... Serre-toi dans tes hardes, fais la momie dans ton manteau : ce vent te coupe la peau et te pèle à la pointe du couteau... Et là-haut, Marsiho est nue. Le mistral lui arrache tous ses vêtements et la nudité révèle la splendeur de la ville. » [7]L'œuvre de Suarès n'est qu'une longue oraison à l'esprit libre, lequel « aura raison du nombre. Et il faut que le nombre le sache, avant qu'il soit trop tard. Et si, d'aventure, le nombre avait raison de l'esprit, c'en serait fait de l'humanité. »[8] La liberté est l'horizon de l'homme, l'amour en est la force, et le courage, la vertu :
« Il faut avoir la force du bien qu'on veut faire. Il faut donc avoir la force d'imposer la paix à ceux qui se fondent sur leur force pour imposer la guerre. Plus on veut le bien, plus on est tenu de ne pas le trahir. La faiblesse des meilleurs est la pire des trahisons. »[9]Au pays des Lumières et du triomphe de la raison, Suarès n'a cessé de soutenir que la raison n'est ni origine ni fin, et qu'elle se noie dans ses propres apories, si elle n'est accompagnée du cœur : « la charité universelle n'est point née de la raison ; c'est la raison universelle qui est sortie de la charité. »[10] Une déclaration salutaire, à transmettre et à incarner sans répit, à l'heure de cette « veillée d'armes »[11].
À suivre.
NOTES
Ariane Bilheran, normalienne (Ulm), philosophe, psychologue clinicienne, docteur en psychopathologie, auteur de nombreux livres dont dernièrement Chroniques du totalitarisme 2021, Vaincre ses monstres intérieurs par la mythologie.
- « Ce qui reste ? Il reste la langue maternelle », conversation avec Günter Gaus (28 octobre 1964).
- H. Arendt, qui confirma être entrée en résistance parce que juive, contrairement à Suarès qui revendiqua une résistance en-dehors de toute appartenance judaïque.
- Anders, S. Et si je suis désespéré, que voulez-vous que j'y fasse ?
- Anders, G. op. cit.
- Suarès, A. Contre le totalitarisme ; Textes politiques (1920-1948), Paris, Les Belles Lettres, 2017.
- Suarès, A. Vues sur l'Europe.
- Suarès, A. Marsiho.
- In Vues sur l'Europe.
- In Contre le Totalitarisme.
- In Vues sur l'Europe.
- Article du 12/02/2023, « Veillée d'armes », Slobodan Despot, Antipresse 376.

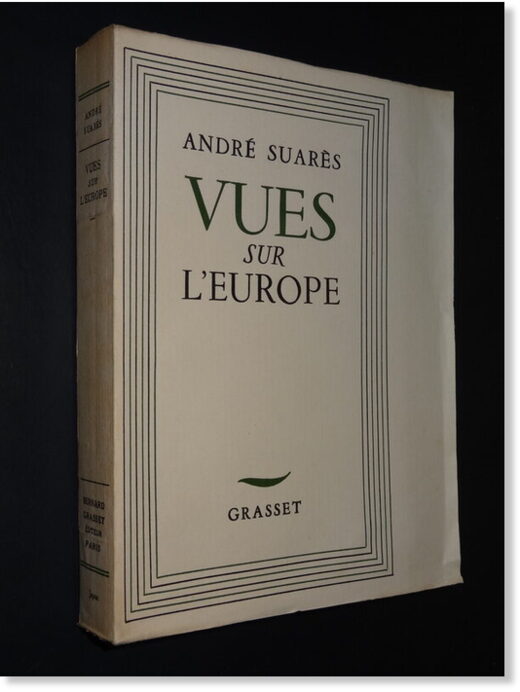
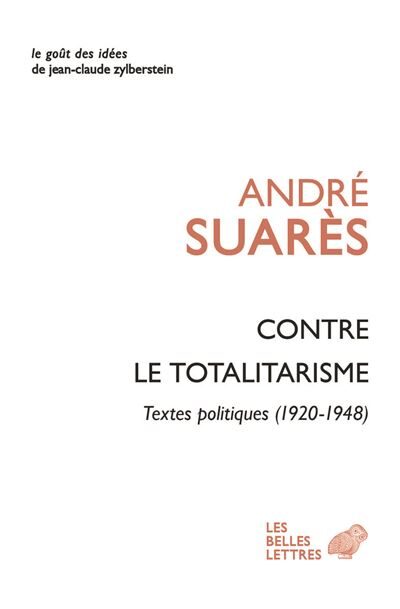



Le réveil d'un homme c'est l'émotion et non l'étau de la possession laconique.