
Des millions de «narcissiques pathologiques» pourraient tous disparaître d'un seul coup en 2013. Pas parce qu'ils guériront ou qu'ils seront internés, ni même (malheureusement pour leurs proches) parce qu'ils deviendront plus faciles à vivre, mais plutôt parce que le narcissisme risque d'être exclu de la liste «officielle» des troubles de la personnalité. Ce qui crée d'ailleurs des remous dans le milieu de la psychologie.
Le narcissisme est, grosso modo, un trouble de la personnalité marqué par un ego démesuré et des idées de grandeur - en fantasmes ou dans les ambitions réelles -, un besoin d'être admiré et un manque d'empathie face aux autres. Typiquement, ce sont des personnalités flamboyantes, compétitives, très centrées sur elles-mêmes, et qui s'attendent à recevoir des traitements spéciaux sur la seule base de la valeur exceptionnelle qu'ils croient eux-mêmes avoir. Leur forte tendance à rechercher l'ascension sociale fait qu'on les retrouve souvent dans des postes de direction, parmi les artistes, les chefs politiques, etc.
«Dans un milieu de travail, ce sont souvent des gens très performants, [... mais] qui vont être très critiques des autres et qui peuvent avoir des remarques méprisantes dans des réunions d'équipe», illustre le psychologue de Québec Sébastien Bouchard, qui fait des troubles de la personnalité sa spécialité. Sur les écrans québécois, poursuit-il, le frère de Sophie Paquin, dans la télésérie du même nom, ainsi que le snob et superficiel Jean-Jacques dans Cruising Bar sont de bons exemples de narcissisme pathologique.
Bien que les estimations varient pour la peine, il s'agit d'un problème assez répandu, ajoute M. Bouchard, qui toucherait entre 1 et 6 % de la population, selon les études.
La «bible» de la maladie mentale
Or, une équipe de l'American Psychiatric Association chargée de réviser le Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders - la «bible» de la maladie mentale, en quelque sorte - propose maintenant d'abolir la moitié des 10 troubles de la personnalité actuellement reconnus, dont le narcissisme. Au lieu d'établir des diagnostics à l'aide de «catégories», il est maintenant proposé d'utiliser une série de «traits» de personnalité, au nombre de 37, qui seraient réunis sous cinq archétypes de personnalité pathologique. L'actuel «trouble narcissique» serait un amalgame de quatre de ces traits - soit le narcissisme, la manipulation, l'histrionisme et l'insensibilité (callousness).
Le travail de révision du DSM doit mener à la cinquième édition de ce manuel, le DSM-5 pour les intimes, prévue pour 2013.
Cette nouvelle façon de procéder, disent ses partisans, aurait ses avantages. «Fonctionner par trait permettrait sans doute des descriptions plus riches, plus raffinées, que des critères diagnostiques un peu statiques», prévoit Marc-Simon Drouin, chercheur en psychologie à l'UQAM. «[...] Le problème avec le DSM actuel, c'est qu'on ne peut que dire si quelqu'un a un trouble ou n'en a pas, et il n'y a que 10 troubles possibles. Alors, c'est assez restreint.»
Cependant, croit-il, ce serait une mauvaise idée que de retirer le narcissisme pathologique des grandes «catégories», car il s'agit d'une réalité indéniable. Et il n'est pas le seul de cet avis.
«Je suis passablement contre cette idée, et je la trouve un peu étrange parce que depuis une dizaine d'années, il y a un regain d'intérêt pour ces troubles-là. [...] Je pense qu'on en voit de plus en plus en clinique.»
Le narcissisme à la hausse
Une étude américaine parue en janvier dernier dans Social Psychology and Personality Science tend d'ailleurs à confirmer ses impressions. Depuis 1994, des chercheurs de l'Université South Alabama mesurent en continu les traits narcissiques d'étudiants du campus grâce à un test où l'on doit choisir parmi 40 paires d'affirmations contradictoires. Un score de 21 ou plus indique un narcissisme prononcé - mais pas nécessairement pathologique, notons-le. Et en 15 ans, la proportion d'étudiants ayant dépassé ce résultat s'est accru de 18 % à pas moins de 34 %.
«C'est de plus en plus fréquent parce que les enjeux narcissiques ont quelque chose à voir avec la réalité contemporaine, analyse M. Drouin. L'érosion du tissu social fait que les gens ont plus tendance à confondre les notions de droit et de désir.»
Même son de cloche du côté de M. Bouchard, qui croit lui aussi que l'approche par traits raffinera les diagnostics, mais pour qui l'abolition d'une catégorie aussi utile que le trouble narcissique doit être revue.
Non seulement est-ce une réalité, dit-il, mais le narcissisme vient souvent compliquer le traitement d'autres problèmes. Il est donc d'autant plus important de maintenir son «statut» de trouble de la personnalité à part entière.
Mais tout n'est pas encore joué, nuance M. Bouchard. L'American Psychiatric Association mène de vastes consultations auprès des cliniciens, et il est bien possible que devant un tollé, elle décide de faire marche arrière. S'ils sont menacés de disparition, les narcissiques n'ont donc pas encore dit leur dernier mot...
La lutte contre la honte
S'il est un problème de santé mentale qui n'attire pas la sympathie, c'est bien le narcissisme. Pas de solidarité, pas de pitié pour ces gros ego surreprésentés chez les batteurs de femmes et qui ne font même pas du bon matériel de film, contrairement aux psychopathes qui, eux, exercent une certaine fascination - voir «Lecter, Hannibal», «Myers, Michael», etc.
Mais bien qu'il existe des narcissiques purs et durs, qui ne sont mus que par un désir de domination et n'éprouvent pas le moindre sentiment pour autrui, beaucoup d'autres sont en fait des gens qui souffrent, rappelle Sébastien Bouchard, clinicien et chercheur en psychologie à la TELUQ. «Une autre vision plus empathique du narcissisme, c'est que c'est un mode de fonctionnement où l'on dépense énormément d'énergie pour lutter contre la honte. Ce sont des gens hypersensibles à tout ce qui ressemble à de la honte [...] qui ont souvent un vécu d'abus et d'humiliation dans leur jeunesse», explique-t-il. «Ce sont des gens généralement qui vieillissent mal et finissent seuls», chez qui l'alcoolisme et le suicide sont plus fréquents que la moyenne, ajoute-t-il.


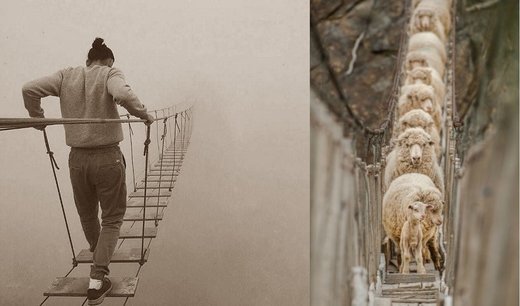
La lutte contre la honte
"S'il est un problème de santé mentale qui n'attire pas la sympathie, c'est bien le narcissisme. Pas de solidarité, pas de pitié pour ces gros ego surreprésentés chez les batteurs de femmes et qui ne font même pas du bon matériel de film, contrairement aux psychopathes qui, eux, exercent une certaine fascination - voir «Lecter, Hannibal», «Myers, Michael», etc.
Mais bien qu'il existe des narcissiques purs et durs, qui ne sont mus que par un désir de domination et n'éprouvent pas le moindre sentiment pour autrui, beaucoup d'autres sont en fait des gens qui souffrent, rappelle Sébastien Bouchard, clinicien et chercheur en psychologie à la TELUQ. «Une autre vision plus empathique du narcissisme, c'est que c'est un mode de fonctionnement où l'on dépense énormément d'énergie pour lutter contre la honte. Ce sont des gens hypersensibles à tout ce qui ressemble à de la honte [...] qui ont souvent un vécu d'abus et d'humiliation dans leur jeunesse», explique-t-il. «Ce sont des gens généralement qui vieillissent mal et finissent seuls», chez qui l'alcoolisme et le suicide sont plus fréquents que la moyenne, ajoute-t-il."
c est un sujet qui m interpelle et qui a suscité ces recherches que je vous partage :
Il n’y a pas de dandysme sans narcissisme
et
Le syndrome de Peter Pan : Ces hommes qui ont refusé de grandir
dans cette section:" L'illusion du miroir" [Lien]
DANDY?
Répondre à la question : qu’est-ce que le dandy, c’est comprendre l’individualité contrariée dans une société de masse. Penser le dandy, c’est d’abord penser deux choses. C’est penser la déféminisation de l’hystérie, et c’est penser sa désexualisation. Pour le comprendre, il faut d’abord faire un bref retour sur la théorie de l’hystérie, puis évoquer la figure du dandy telle qu’elle s’est constituée au XIXe siècle. Ce cheminement amènera à rencontrer des figures plus mineures de l’hystérie : le mondain, le sophistiqué, le bohème…
Un extrait de Maurice Barrès le montre tant par le fond que par la forme littéraire qui est la sienne :
« A certains jours, se disait-il, je suis capable d'installer, et avec passion, les plans les plus ingénieux, imaginations commerciales, succès mondains, voie intellectuelle, enviable dandysme, tout au net, avec les devis et les adresses dans mes cartons. Mais aussitôt par les Barbares sensuels et vulgaires sous l'oeil de qui je vague, je serai contrôlé, estimé, coté, toisé, apprécié enfin; ils m'admonesteront, reformeront, redresseront, puis ils daigneront m'autoriser à tenter la fortune; et je serai exploité, humilié, vexé à en être étonné moi-même, jusqu'à ce qu'enfin, excédé de cet abaissement et de me renier toujours, je m'en revienne à ma solitude, de plus en plus resserré, fané, froid, subtil, aride et de moins en moins loquace avec mon âme. » (Le culte du moi I. Sous l’œil des Barbares).
L’écriture – on le voit chez Barrès - fait partie du fétichisme du dandy ;
c’est pour lui une façon de s’aimer narcissiquement.
Le dandy se fait parfois aussi collectionneur. C’est encore une des formes de son fétichisme. Pierre-Marc de Biasi a prétendu que la mise en scène de collectionneurs dans les livres de Balzac constitue une compensation de « l’échec de la satisfaction sexuelle par la division fétichiste du plaisir ». La « collectionnite » du dandy peut notamment être collection de rencontres prostitutionnelles. Le dandy ne recherche pas une compagne, ni plusieurs amantes – les femmes l’ennuient parce que l’altérité l’ennuie – il recherche des jeux de miroirs, et la prostituée, par la multiplicité des désirs qu’elle « centralise », dont elle est, en d’autres termes, le réceptacle, parvient bien à donner la réplique au dandy. Par son biais, il s’opère en sorte un transfert de centralité au profit du dandy. Avec la prostituée, le dandy en a, dans tous les sens du terme, pour son argent. La marchandisation, il l’a, la fétichisation du corps, le sien et celui de la femme, il l’a. L’anhistoricité de son acte, il l’a. La séduction et l’esquive, il l’a. Fausse séduction et vraie esquive bien sûr. Mais n’est-ce pas exactement ce qu’il recherche ? Sauf accident, qui serait l’apparition d’un don ou d’un contre-don, le dandy a donc tout ce dont il a besoin pour alimenter son autoportrait. La prostituée, à la fois « duchesse » et « grisette », soumise et maîtresse du jeu, satisfait aussi le goût du dandy pour le brouillage des identités tout autant que pour la généralisation de l’échange marchand. Il y a là une fascination dans laquelle Georg Simmel voyait une antidote à l’angoisse du pur objet (Philosophie de l’argent, 1903).
Le dandysme comme ennui de l’autre:
Dans tous les cas, le dandy est un personnage à qui il n’arrive rien, au sens où il n’est jamais changé, jamais affecté par ce qui lui arrive ; il n’est pas sujet à de vraies émotions, et encore moins à de vrais changements de direction de vie. Le dandy n’est d’ailleurs pas sujet du tout, il est l’objet de son dandysme, le dandysme l’agit, il est la femelle de son dandysme. C’est pourquoi A rebours, le roman de Huysmans dont le personnage est Les Esseintes est un roman « sans action ni dialogue ». Pour le dandy, il ne se passe jamais rien.
Le dandy est fétichiste. La fétichisation des morceaux du corps, et du corps en morceaux correspond aussi à cette fascination exercée par la prostitution. Pour le fétichiste, c’est précisément la valeur d’échange qui est plus fascinante que la valeur d’usage. La femme peut aussi représenter, comme Salomé dans A Rebours de Huysmans « la déité symbolique de l’indestructible Luxure, la déesse de l’immortelle Hystérie, la Beauté maudite » . Là encore, il s’agit d’esquisser, et non de représenter : Salomé n’est pas l’hystérie mais sa déesse. Esquisser et esquiver : le goût de l’hystérique est dans l’inachèvement. Aucun aboutissement n’est possible. L’hystérique est hors désir : si le mélancolique peut être au delà du désir, - il l’a expérimenté et il l’a déposé dans un passé qui n’est plus –, l’hystérique est en deça.
L’ennui est la coquetterie du dandy. C’est son fétiche. Mais quand il n’y a que de l’ennui, il n’y a pas forcément dandysme, il peut n’y avoir que la simple figure du bohème, celui qui rechigne à s’engager dans le monde, qui est chichiteux, en somme, quant aux prises de parti dans le domaine professionnel, amoureux, politique, sociétal. C’est en ce sens que le bohème se cherche voire se dérobe au sens de l’esquive et de la latéralité dandyste. Mais le terme bohème désigne plutôt un mode de vie alors que dandy désigne une organisation de la personnalité.
C’est naturellement un ennui de l’autre qu’éprouve le dandy, puisque l’autre ne l’intéresse pas bien qu’il en ait besoin continuellement comme miroir. C’est le cas échéant un ennui de la femme (comme figure de l’autre). L’ennui a l’avantage pour le dandy d’être auto-référentiel. Il est aussi inspiré du modèle culturel féminin de l’attente, l’attente du prince charmant irréel, le réel n’étant « jamais assez bien ». Le dandy prétend réagir à l’ écoeurement d’un monde où « tout se répète » mais c’est surtout lui qui ne sait pas se renouveler.
Qu’est ce que l’ennui ? Le sentiment de non implication dans le monde, un sentiment de non responsabilité de soi. Le dandy vit avec un sentiment d’étrangeté au monde – alors que le monde est, que cela plaise ou non au dandy, le seul accès au soi (il n’y a pas de « soi intérieur », de soi hors monde, hors l’épreuve du monde et les preuves du monde). Le rapport du dandy au monde, c’est un romantisme dans le plus mauvais sens du terme. C’est le roman préféré à la vie. C’est une « neurasthénie délicate » (Emilien Carassus). C’est pourquoi, si le dandy se veut élégant, il n’est jamais, dans la mesure où il n’aime personne, « un vrai gentleman », comme le remarqua William Maginn.
L’incertitude identitaire de celui qui s’ennuie se voit bien dans ce propos de Barbey d’Aurevilly : « Je ne sais pas ce que j’aurais donné ce soir pour ne pas être moi-même ». Attention : ce dont il est question n’est pas la panique du phobique qui ne supporte pas la centralité qu’il pense devoir assumer et dont il surestime l’impact. L’ennui, c’est l’ère du vide et ce n’est donc ni la phobie ni le tourment des passions. Léo Bersani disait que le dandysme était « une forme d’individualité non personnelle ». Comme la femme fatale, le dandy n’est personne. A la chaleur des passions, le dandy préfère l’ennui froid. Ennui de s’être perdu lui-même. Froideur de ne pouvoir s’aimer, et ainsi de pouvoir aimer les autres. Une hystérie blanche comme nous l’avons écrit plus haut.
Dans le mélange d’apparaître et de retrait, et de dérobade du dandy, il y a un problème de distance. Le dandy n’a pas la bonne distance de celui qui a vécu, le dandy a le figé de celui qui ne peut s’engager dans le monde mais ne peut néanmoins plus se prévaloir de sa juvénilité. Le dandy met trop de distance dans ses relations sociales, distance à lui, distance aux autres, mais il a peur de cette distance et tente de l’apprivoiser par des pirouettes.
Les quelques dandys balzaciens qui ne se brûlent pas les ailes sont ceux qui font preuve du plus grand cynisme. Calculateurs, froids et manipulateurs, ils n'en présentent pas moins un extérieur d'une élégance parfaite et une frivolité dans les sentiments. Ils sont tout à leur apparence, l'arme principale dans le combat du séducteur. Leur récompense, c'est la réputation dont ils jouissent dans le monde et l'influence qu'ils y exercent. Les plus cyniques se font entretenir par les femmes qu'ils compromettent. La séduction d'une femme aisée se traduit donc par l'indépendance financière du séducteur, mais nombreux sont ceux qui, tombant amoureux d'une actrice au succès - et à la fortune - éphémère, dépensent jusqu'au dernier écu de la maigre fortune familiale. C'est l'amour du beau Lucien de Rubempré pour Eve qui cause sa perte, ruine sa famille, manque de lui ôter la vie et lui prend son âme.
VOIR CETTE ETUDE:[Lien]