
La mort de l'écrivain colombien Gabriel García Márquez, 87 ans, prix Nobel 1982, est celle d'un symbole littéraire et politique, véritable pop star du rêve et du drame latino-américains des années 1960. C'est aussi celle d'un homme devenu l'ami et le fidèle soutien d'un maître abusif des rêves égalitaires et des illusions perdues, le dictateur Fidel Castro. Son plus célèbre roman, «Cent ans de solitude», paru en mai 1967, le jour même où sortait le «Sergent Peppers» des Beatles, allait marquer une langue et une époque.
Le romancier exportait la vie d'un continent et définissait avec d'autres, ceux qu'on appela les écrivains du «boom» latino-américain, les contours d'un nouvel imaginaire. «Dans les bonnes consciences de l'Europe, et aussi parfois dans les mauvaises, a fait irruption avec plus de force que jamais l'actualité fantasmatique de l'Amérique latine, cette immense patrie d'hommes hallucinés et de femmes entrées dans l'histoire, dont l'obstination infinie se confond avec la légende», disait-il à Stockholm en recevant son prix.
Avant d'être romancier, García Márquez fut un excellent journaliste - d'abord à Barranquilla, puis, en Amérique latine et en Europe, pour l'agence Prensa Latina. L'un de ses plus fameux textes, Récit d'un naufragé, est publié en vingt épisodes dans El Espectador en 1955 : c'est l'histoire d'un marin militaire qui, après être tombé de son navire, survit dix jours en haute mer. Les qualités de García Márquez sont déjà là - des qualités classiques : précision, sens de la narration, attention au détail et oreille pour la langue des autres. Jamais il ne renoncera à un métier qu'il n'a cessé de célébrer, et pour lequel il a créé à Carthagène une Fondation pour un nouveau Journalisme latino-américain, toujours en activité. De même, sa passion du cinéma le poussera à créer, en 1986 à Cuba, l'Ecole internationale de San Antonio de los Banos, qui a formé des générations de scénaristes et de cinéastes latino-américains.
« Pouvoir magique »
Gabriel García Márquez s'est installé au Mexique dans les années 60 , sans argent, avec sa femme Mercedes, lorsqu'il décide de s'enfermer et d'écrire son grand roman. L'histoire de sa gestation est devenue une légende rétrospective que son biographe, Gerald Martin, a fort bien racontée en 2008 : chacun semble attendre le chef-d'œuvre avec autant d'impatience que de certitude. Il est écrit pendant un an sur une vieille Olivetti dans une pièce de trois mètres sur deux, baptisée «la caverne de la mafia». L'auteur dira plus tard, avec cette vaniteuse ingénuité qui le caractérise et que la réalité confirme : «Dès le premier instant, bien avant sa publication, le livre a exercé un pouvoir magique sur tous ceux qui entraient en contact avec lui : amis, secrétaires, etc., même des gens comme le boucher ou le propriétaire attendaient que je le termine pour être payés.» Il doit huit mois de loyers. Le soir, ses amis viennent écouter les feuillets qui sortent du livre et encouragent, en quelque sorte, le meilleur d'entre eux. La dactylo rapporte les manuscrits chez elle et les lit aussi à ses amis après les avoir tapés. Un jour, elle manque être renversée par un bus. Les feuillets s'éparpillent dans la rue comme feuilles dans la bourrasque, titre de la novella de García Márquez où apparaît pour la première fois, en 1955, le nom du village de Macondo. Le manuscrit est achevé un jour vers 11 heures du matin.
García Márquez a entendu parler pour la première fois de Fidel Castro en 1956 à Paris. Journaliste, il arrive à La Havane le 19 janvier 1959, quelques jours après la prise du pouvoir. Ce qu'il y voit et vit explique sans doute largement le fait que jamais il ne reniera le régime castriste : la révolution cubaine représente tout ce dont les peuples latino-américains opprimés semblent rêver : la jeunesse, le partage, l'éducation pour tous, l'absence de compromis avec les forces militaires et capitalistes. Socialiste anti-soviétique, García Márquez ne peut que soutenir avec enthousiasme l'expérience à ses débuts. Il lui faudra cependant 15 ans et bien des gages pour rencontrer celui qui deviendra son ami : Fidel Castro. Il le restera malgré les moments de tension et de répression.
En 1975, l'année de la rencontre avec Castro, il publie «l'Automne du patriarche», son second chef-d'œuvre. Pour l'auteur lui-même, l'histoire du dictateur Zacarias est «presque une confession personnelle, un livre totalement autobiographique, quasiment un livre de mémoires. Bien entendu, ce sont des mémoires codés ; mais si à la place d'un dictateur on met un écrivain très célèbre et terriblement gêné par sa gloire, avec cette clé, on peut lire le livre et le comprendre.»
Il y aura encore de bons romans, «Chronique d'une mort annoncée», «le Général dans son labyrinthe», «l'Amour au temps du choléra». Il y aura le prix Nobel, et le rôle important joué pendant la guerre civile colombienne opposant le pouvoir aux FARC. Mais, à partir de la seconde moitié des années 1970, la statue est boulonnée. Souffrant d'un cancer de la lymphe depuis 1999, le lion devenu vieux passait son temps entre Mexico et Cuba. Son dernier roman, «Mémoire de mes putains tristes», a été publié en 2004. Il raconte la passion érotique d'un homme de 90 ans pour une jeune femme, Delgadina, qui en a quatorze. C'est un livre d'un deuil solaire, où tout ce qu'une vie peut donner de solitude se dissout dans la célébration active et silencieuse d'un corps. Les meilleurs romans de García Márquez sont, eux aussi, des jeunes filles, toujours sur le point de se réveiller d'un profond sommeil, et qui rendent au lecteur la sensualité qu'ils n'ont cessé, phrase après phrase, d'absorber : «Car aux lignées condamnées à cent ans de solitude, écrit-il dans le roman qui fit sa gloire, il n'est pas donné de seconde chance sur la terre.»

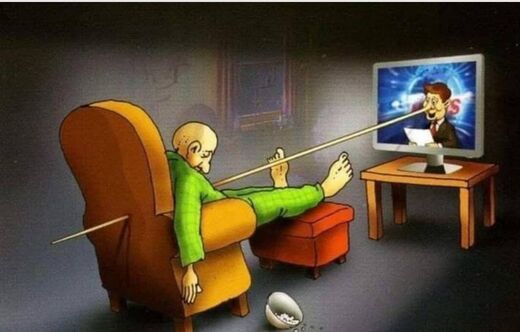

Commentaires des Lecteurs
Lettre d'Information